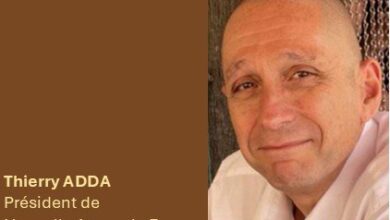Symbolisme du jardin

Jardin d’Eden, jardin des Hespérides, jardin médiéval, jardin de Versailles… le jardin représente autant d’espaces mythiques que réels et son intérêt s’est développé à travers les siècles.
Le jardin – un lieu où la nature apparaît encadrée, ordonnée et cultivée – est un symbole de la conscience humaine qui a dominé l’inconscient le plus instinctif et inférieur. C’est le milieu où la nature apparaît soumise et où règne l’ordre face au chaos externe.
Le jardin dans les religions
À travers les religions, le jardin représentait le paradis (dont le mot vient du persan pairidaeza (« enclos sacré »).
Dans la Bible, le jardin d’Éden est le premier lieu de l’humanité : un lieu de félicité originelle, harmonie parfaite entre l’Homme, Dieu et la Nature.
Le jardin devient ainsi un symbole du paradis terrestre, du « jardin d’Eden », où le Créateur a installé et où vécut heureux le premier couple humain – Adam et Ève – jusqu’à leur chute et leur expulsion. Selon la Genèse, Adam cultivait ce royaume naturel où toute forme de vie était respectée et où régnaient la beauté et l’harmonie.
Dans le Coran, le jardin représente également le paradis éternel promis aux croyants (en arabe, le mot janna signifie « jardin »).
Le taoïsme a développé le concept de jardin comme un lieu d’intimité et de calme, un paradis projeté pour refléter le ciel sur la terre.
Les cloîtres des monastères, les jardins de l’Alhambra et les villas du quartier de l’Albaicin de Grenade, le jardin fermé des maisons musulmanes, tous, avec leurs fontaines centrales, susurrant le murmure de l’eau, sont des images qui nous rappellent le jardin d’Eden. Tant les patios des couvents que les cloîtres des églises médiévales sont l’exemple parfait de ce Jardin qui symbolise le Paradis.
Le jardin devient alors un lieu sacré de paix, lieu d’origine, lieu bosquet sacré, otium,contemplation,de vie protégé.
Le jardin dans l’Antiquité gréco-romaine
Les philosophes se réunissaient dans les jardins : l’Académie de Platon dans un bosquet sacré, Épicure et ses disciples dans son jardin d’Athènes.
Les Romains pratiquaient l’otium, un loisir studieux, dans des villas avec des jardins conçus pour la contemplation et la culture de soi.
Ainsi le jardin devient un lieu d’apprentissage, de retraite et d’harmonie.
Le jardin médiéval
Au Moyen-Âge, le jardin hortus conclusus (jardin clos) est clos de murs, structuré, souvent petit : c’est un lieu de représentation spirituelle. Il symbolise la Vierge Marie, un lieu pur et protégé, empreint de spiritualité et de fertilité.
Dans certaines abbayes, comme à Saint-Georges de Boscherville, en Haute Normandie (1), on y trouve des plantes aromatiques, un verger et surtout un jardin de plantes médicinales pour soigner. Ce jardin a été recréé à l’identique du Moyen-âge par des dessins et documents du XVIIe siècle.
Les plantes avaient un côté symbolique : la rose pour l’amour divin, le lys, symbole de pureté, la vigne représentant le Christ…
Le jardin devient alors un espace sacré et codé, un miroir de l’âme chrétienne.
Le jardin Renaissance et baroque : ordre et pouvoir
À la Renaissance, le jardin prend une tout autre allure. Il devient, avec les « jardins à la française », une mise en scène de l’influence de l’homme sur la nature : géométrie parfaite, perspective, notamment avec le jardin de Versailles, conçu par Le Nôtre pour le roi Louis XIV. C’est un symbole du contrôle de la raison et du pouvoir royal. Il exprime la maîtrise humaine sur le monde vivant.
Le jardin devient alors artificiel et majestueux, image de l’ordre humain et politique
Le jardin romantique : nature retrouvée
Au XVIIIe siècle, avec le Siècle des Lumières et le romantisme, apparaît le jardin à l’anglaise. Plus libre que celui à la française, irrégulier, traversé de rivières, de grottes, de ruines, il évoque le mystère, le sublime, le retour à la nature perdue. Il devient un lieu de rêverie et de mélancolie et d’imagination (avec notamment l’influence de Jean-Jacques Rousseau)
Le jardin devient alors intime, émotionnel et poétique.
Le jardin contemporain : écologie, mémoire, expérience
Aujourd’hui, les jardins ont des significations très différentes.
Ce sont, dans certains cas, des lieux écologiques où l’on pratique la permaculture (jardins partagés par exemple) avec la présence de biodiversité de tous les règnes du vivant.
Ce sont également des lieux de mémoire (jardins de la Shoah, jardins du souvenir : lieu dans le cimetière où l’on répand les cendres des défunts qui n’ont pas de tombe).
Enfin, ce sont des espaces végétaux représentant la ville de demain (jardins verticaux le long des murs, toits végétalisés).
Le jardin devient alors engagement, refuge, lien au vivant et à l’avenir.
Le jardin zen : paix et tranquillité
Comme une oasis qui apparaît dans l’aridité du désert ou une île au milieu d’une mer démontée, le jardin japonais évoque le plaisir de jouir d’une oasis de paix et de tranquillité au milieu de la désolation et du chaos de la nature inculte qui l’entoure.
Le jardin japonais ou jardin Zen reproduit des paysages naturels dans une organisation au millimètre près où rien n’est laissé au hasard. Le paysage naturel est reproduit en modèle réduit avec ses reliefs, ses cours d’eau, ses îlots et ses chemins.
Sept principes directeurs sont présents : l’austérité (Koko), la simplicité (Kanso), le naturel (Shinzen), l’asymétrie (Fukinsei), le mystère ou la subtilité (Yugen), la magie ou l’originalité (Dasizoku) et le calme (Seijaku).
Propice à la contemplation et au détachement, il permet à ceux qui s’y promènent, de se vider l’esprit un instant pour mieux se ressourcer
Les jardins chinois : lieux de forces complémentaires
Les jardins chinois sont constitués de certains éléments symboliques incontournables comme la pierre, l’eau, le végétal et l’architecture. En veillant à recréer un microcosme de la nature, le jardin chinois incite au déplacement, à la promenade, aux déambulations, afin de découvrir les lieux, les secrets et les surprises qui s’y cachent. Il ne peut pas se dévoiler en un seul regard mais demande du temps et de la patience pour être entièrement découvert.
Il se base également sur des forces complémentaires, le Yin et le Yang, ainsi que sur des éléments opposés qui se complètent : éléments humides et secs, zones d’ombre et de lumière, zones minérales et végétales…
Matrice fertile, le jardin est lié au principe féminin. Espace d’accueil, d’enracinement, de gestation et de renaissance, il reflète les cycles de la vie et la beauté du vivant.
Il est également un symbole féminin d’accueil, dans lequel la fontaine centrale qui le régit est l’élément masculin qui le féconde, image d’union et de complémentarité.
Lieu de rencontre le Ciel et la Terre le Divin et l’Humain
Le jardin symbolise le lieu où le ciel étoilé et la terre en fleurs se confondent.
Dans la mystique soufie, le jardin est la représentation du cœur purifié, où Dieu peut se refléter. Il est ce lieu secret, intérieur, où l’âme rencontre l’Amant divin. Le jardin devient alors un miroir de l’amour spirituel, un lieu d’union entre l’humain et le Divin.
Dans les traditions hindoues, les jardins célestes comme Nandana ou Vrindavan sont les lieux de jeu des divinités, notamment Krishna. Ils symbolisent la félicité divine, la beauté, le jeu cosmique (lila) et l’union mystique.
La représentation de l’âme
Dans la Kabbale, le Pardès signifie à la fois « verger « et voie vers la sagesse divine. Il représente une descente dans les profondeurs de l’âme à travers les niveaux d’interprétation des textes sacrés.
En alchimie, le jardin est un locus secretus, espace clos du Grand Œuvre. Il symbolise la transformation de l’âme, le travail sur soi, la culture des vertus et la quête d’unité intérieure.
Pour le psychanalyste des rêves, le jardin est un symbole onirique du Soi, reflet d’une psyché harmonieuse. C’est le lieu idéal pour la culture et la croissance de la vie intérieure, de notre propre jardin intérieur.
Le jardin, espace initiatique
Lieu de passage, le jardin initiatique s’explore comme un labyrinthe : il ne se livre pas d’un coup d’œil mais demande une marche patiente. Le centre du jardin — souvent une fontaine, un arbre ou un autel — représente le cœur, la vérité, l’union retrouvée.
Le jardin est bien plus qu’un espace vert : il est une image archétypale de l’harmonie entre l’homme et la nature, entre l’âme et l’esprit. À travers les âges et les civilisations, il nous parle toujours d’équilibre, d’éveil, de beauté, de mémoire et d’espérance. Cultiver son jardin, c’est cultiver son intériorité, son lien au vivant et son ouverture au sacré.