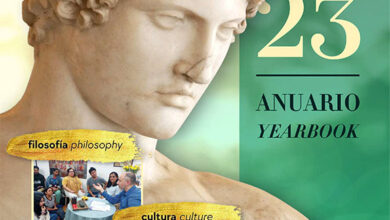Editorial : Quand la beauté entre en résistance !

Selon les paroles prêtées par Marguerite Yourcenar à l’empereur romain Hadrien, il nous appartient de nous sentir responsables de la beauté du monde. Question essentielle aujourd’hui…
Mais comment discerner où est notre responsabilité dans un monde qui s’enlaidit à une vitesse vertigineuse, où bien souvent la laideur morale le dispute à la laideur de notre environnement ?
Dans cet environnement où les yeux des passants rivés sur leur portable semblent devenus indifférents, parvenons-nous à résister, à discerner la beauté qui se dérobe, mais qui pourtant subrepticement toujours se manifeste ? Assumons-nous que notre attention est aujourd’hui dirigée vers tant intérêts pas toujours bien intentionnés ? Ou bien glissons-nous dans une pensée indolente, vers une dispersion soumise, où l’attention ne peut plus se frayer un chemin ?
Le risque du renoncement est grand, et notre monde est si confus, que certains pays comme la Chine, en sont venus à créer des voies piétonnes aux signalétiques spéciales pour ceux que l’on appelle aujourd’hui « smombies » (1), délicate contraction de smartphone et de zombie. Et la beauté, que devient-elle ?
Prenons garde car L’amor mundi d’Hannah Arendt, cet engagement profond envers le monde malgré ses imperfections, est lié à notre capacité à percevoir la beauté du monde, aujourd’hui bien malmenée. Comme le dit Alain Finkielkraut (2) : « L’oreille collée à son téléphone portable ou les yeux rivés sur celui-ci, on ne voit plus l’autre, on ne voit plus rien, le regard s’efface et avec lui « l’amor mundi » ». Car, même si la beauté fait de la résistance, elle a besoin d’être transmise, le Beau d’être enseigné, là où aujourd’hui il est condamné, voire nié au nom d’une subjectivité érigée en dogme. N’oublions pas que quand la beauté disparaît, c’est un peu de notre humanité qui s’envole, nous laissant orphelin. « Puisque le beau n’existe pas, la laideur a droit de cité dans le monde. La dévaluation du regard est érigée en victoire sur les préjugés » poursuit-il, ce qui revient à « jeter sur l’enlaidissement du monde, le voile de l’accoutumance ».
L’accoutumance ou habituation pour les scientifiques, voilà le piège ; son processus rend les êtres de moins en moins réceptifs aux stimuli répétitifs. Un comportement que les humains partagent avec les animaux et les bactéries (3) et qui petit à petit nous insensibilise à la laideur. Malmenée, peu à peu invisibilisée, la beauté en vient trop souvent à être chassée de l’art qui devrait être son sanctuaire, y perdant son identité au nom des bienfaits supposés d’une consommation accessible au plus grand nombre.
Pour autant, la partie n’est pas perdue, et tout n’étant que flux et reflux, une prise de conscience salvatrice collective émerge, refusant le rapt permanent des consciences par l’inutile et le superficiel. Des musées comme la Manchester Art Gallery au Royaume-Uni, mettent à disposition, à côté des espaces d’exposition classiques, une salle différente, un espace pour respirer où les visiteurs sont priés de s’asseoir et de contempler les œuvres pour « les voir vraiment ». Comme en témoigne la B.B.C. (4) : « Dans un monde où notre regard est sollicité tous azimuts, où l’attention est une ressource précieuse, ce lieu de contemplation est un endroit où reconquérir notre capacité d’attention ». D’autres musées emboîtent le pas, comme le musée Van Gogh à Amsterdam, avec toujours le même objectif. « L’idée est qu’en ralentissant et en prenant le temps d’observer, vous vous redonniez la capacité de voir la beauté. Et cela a des effets bien plus larges. Faire une pause pour prendre le temps de considérer une œuvre, c’est faire une place au sens. »
Loin donc de s’éteindre, la résistance du sens progresse, gagnant chaque jour de nouveaux territoires, à la recherche du Beau qui désaltère l’âme. Il en est ainsi du retour en grâce de la poésie.
Vilipendé, moqué, mais porté par un engouement des lecteurs (5), ce tout petit secteur de l’édition a vu son chiffre d’affaires croître de 17% en 2024. Le nombre d’exemplaires décolle pour atteindre des niveaux impensables avant l’épidémie de Covid. La prise de conscience est réelle, l’art touche à notre identité profonde.
Quand les repères d’une société sont menacés, la culture au sens noble devient existentielle. En témoigne la situation en Ukraine où comme l’écrit le journal Le Monde (6) : « C’est le début d’un âge d’or pour la culture en Ukraine, il y a foule dans les musées, les théâtres, et partout de nouvelles librairies ouvrent leurs portes ». Pourquoi un tel engouement ? Alain Finkielkraut nous en donne la clé : « Les écrivains, les poètes, les philosophes ou les romanciers nous apprennent à voir. Quand ils s’éclipsent, quand ils ne sont plus enseignés… le regard s’éteint et il n’y a plus d’obstacle aux avancées de la laideur ».
La survie du Beau comme puissance de l’âme, se joue dans l’apprentissage de notre regard. Comme le dit si bien François Cheng (7) : « C’est bien grâce à la beauté qu’en dépit des conditions tragiques nous nous attachons à la vie. Tant qu’il y aura une aurore qui annonce le jour, un oiseau qui se gonfle de chant, une fleur qui embaume l’air, un visage qui nous émeut, une main qui esquisse un geste de tendresse, nous nous attarderons sur cette terre si souvent dévastée. »
Non, la beauté n’est pas un luxe, mais bien un fondement de l’existence humaine, elle est liée à la vertu tant chérie par les Anciens. « La bonté, est garante de la qualité de la beauté ; la beauté elle, irradie la bonté et la rend désirable ».
Beauté et bonté donnent vie à notre regard et sens au monde qui nous entoure, par-delà toute souffrance et toute désespérance. L’art sort alors des musées pour envahir le monde… car poser un regard de philosophe, c’est redécouvrir un certain art de vivre où la beauté est toujours présente…