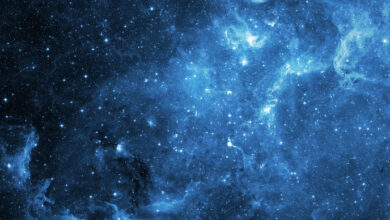Rencontre avec des philosophes : Proclus, le dernier des philosophes de l’Antiquité
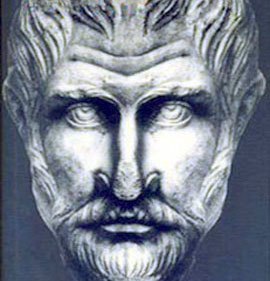
Faisant suite aux philosophes de l’école néoplatonicienne que furent Plotin, Porphyre et Jamblique, Proclus semble terminer le cycle de la sagesse de l’Antiquité en prenant en charge l’école platonicienne d’Athènes. Il offre une synthèse des interprétations philosophiques et des pratiques théurgiques de ses successeurs.
Proclus naquit à Constantinople, le 8 février 412, sous le règne de l’empereur Théodose II, au sein d’une famille aisée, originaire de Xanthos en Lycie. Son père, Patricius, se trouvait à Byzance, effectuant quelques démarches et la famille retourna rapidement dans sa région natale.
Lorsqu’il eut terminé ses études basiques, son père l’envoya à Alexandrie pour suivre une formation de juriste. Il étudie le latin avec le grammairien Orion et le droit avec le prestigieux sophiste Léonas, qui l’emmène à Constantinople pour remplir une mission commandée par le gouverneur Théodore et compléter sa formation. À cette époque, le jeune Proclus a constaté son penchant pour la philosophie, avec une préférence pour le droit.
L’attrait pour la philosophie
De retour à Alexandrie, il suit les cours du mathématicien Héron et du péripatéticien Olympiodore, mais l’orientation de ce philosophe ne le satisfait pas et il décide de se rendre à Athènes, où Syrianos commençait à remplacer le vieux Plutarque à la direction de l’école platonicienne.
À l’époque, Athènes, très bien entretenue par les Antonins, en particulier par Marc Aurèle, disposait d’une grande école, financée par le trésor impérial, où des érudits de différentes disciplines enseignaient avec une orientation platonicienne.
Proclus, cherchant la proximité avec la déesse Athéna, dont il était dévot, s’installe au sud
de l’Acropole, à côté du sanctuaire d’Asclépios.
Apparemment, le jeune aspirant fit une profonde impression sur le maître Plutarque, qui, bien qu’il soit déjà retiré de l’enseignement, l’instruisit personnellement des enseignements de Platon et d’Aristote sur l’âme et, deux ans avant sa mort à l’âge de 74 ans, le confia spécialement à Syrianos dont Proclus se considéra toujours le disciple. Il lui enseigna les mystères de la Théurgie et lui conféra le statut d’initié et de « pontife ».
Dans le même temps, Asclépigénie, fille de Plutarque, l’instruisit de la sagesse des « Oracles chaldéens », dont Porphyre avait déjà introduit l’étude à l’école au IIIe siècle.
À la mort de Syrianos, probablement en l’an 450, Proclus reste à la tête de l’école, fonction qu’il gardera jusqu’à sa mort le 17 avril 485. Ce travail lui valut le titre de « diadoque », c’est-à-dire successeur de Platon.
Nous savons par son biographe Marinus, de Néapolis en Palestine – qui fut son disciple et successeur – qu’il eut du prestige et de l’influence dans la société athénienne, et qu’il prit une part active à la vie publique de la ville, assistant à des réunions et des délibérations, où il exposait ses points de vue philosophiques sur des questions relatives aux lois et au gouvernement des villes, en particulier Xanthos et Athènes. Il orienta les pas d’Archiadas, petit-fils de Plutarque, dans la vie politique, le conseillant et le guidant. Il fut également persécuté et dût s’exiler volontairement pendant un an en Asie.
On raconte que lorsque la statue d’Athéna fut retirée du Parthénon, la déesse, qui était apparue au philosophe en d’autres occasions décisives, se présenta à lui en lui disant : « Ils m’ont sortie de mon temple, maintenant je vais vivre avec toi ».
Une activité philosophique intense
Sur le plan religieux, il cherchait une conciliation des différentes croyances, et aimait à se qualifier « prêtre de toutes les religions ». Ses critiques du christianisme ne dépassèrent jamais le plan philosophique. Il affirmait que le véritable philosophe « doit veiller au bien non seulement d’une ville et des coutumes d’un seul peuple, mais qu’il doit être un hiérophante commun du monde entier ».
Marinus nous raconte qu’il avait l’habitude de donner chaque jour cinq cours ou séminaires et d’écrire sept cents lignes. Une telle intensité de travail ne l’empêchait pas d’organiser des réunions avec d’autres philosophes et des soirées informelles. Le soir, il se livrait à ses dévotions et composait des hymnes à la manière orphique, consacrant de nombreuses heures à la prière, au moins trois fois par jour. Il adopta l’abstinence pythagoricienne et refusa toujours le mariage.
Son meilleur ami et collègue fut Archiadas. Il s’entoura de disciples, dont nous connaissons certains noms, comme Ammonius et Héliodore d’Alexandrie, Théagène, un sénateur riche et libéral, Panégrapios de Thèbes, Zénodote ou le Marinus déjà cité. L’un de ses meilleurs disciples, Asclépiodore, cependant, s’éloigna avec le temps des enseignements de son maître et adhéra au scepticisme.
Il meurt le 17 avril 485 à l’âge de soixante-treize ans et est enterré à côté de son maître Syrianos, près du mont Lycabette. Marinus se chargea de l’Académie et à sa mort lui succéda son disciple Damascius qui était à la tête de l’école lorsqu’en 532 l’empereur Justinien ordonna la fermeture des écoles de philosophie.
La dialectique entre l’Un et la multiplicité
L’œuvre philosophique de Proclus se caractérise par son originalité lorsqu’il s’agit d’interpréter et de systématiser les enseignements de Platon, Porphyre et Plotin, sans oublier l’œuvre de Jamblique, même s’il élabore ses propres critères et apporte ses propres conclusions.
Proclus s’efforce d’expliquer de manière pédagogique les principales doctrines, en particulier l’émergence de la multiplicité des êtres à partir de l’ineffable Un, les relations des causes et des effets, opérant au long de l’échelle des êtres, suivant une cyclicité rythmique dans la manifestation dynamique.
Pour résoudre la dialectique entre l’Un et la multiplicité, il recourt d’une certaine manière au concept de la participation du multiple à l’Un, car le multiple obtient son existence de l’Un. De telle sorte que chaque niveau de l’être correspond à un niveau de conscience indépendant de toute conscience individuelle.
Les doctrines sur l’Âme
Les doctrines sur l’âme furent un objet d’études de la part de notre philosophe, comme l’un des thèmes centraux de sa philosophie. Ainsi, dans ses Éléments de théologie, il établit une certaine hiérarchie des âmes, selon leur participation à l’intellect divin.
« Certaines âmes sont illuminées par une lumière divine, qui brille sur elles, d’autres sont dotées d’une intelligence perpétuelle, d’autres enfin participent parfois à cette perfection. Les âmes du premier groupe seraient analogues aux dieux, celles du second groupe suivraient toujours les dieux, recevant d’eux l’énergie selon l’intellect et seraient liées aux âmes divines avec lesquelles elles auraient la même relation que l’intellectuel en rapport à ce qui est divin. Quant aux âmes qui ne reçoivent que parfois l’énergie intellectuelle et suivent les dieux, elles ne participent pas toujours à l’intellect de la même manière, et ne sont pas toujours prêtes à s’adapter à l’intelligible en conjonction avec les âmes divines… »
Les dieux, hiérarchies de pouvoir
Quant aux dieux, Proclus les définit comme des hiérarchies de pouvoirs qui participent à l’ordre providentiel, puisque l’univers des réalités mentales est toujours supérieur à celui des réalités matérielles. Ces pouvoirs sont au-delà de l’être humain qui ne développe pas les vertus qui lui permettraient de participer avec connaissance à cet ordre hiérarchique. L’amour est le pouvoir qui conduit l’homme vers le divin et rayonne également dans le monde, stimulant l’effort qui naît de l’impulsion, le principe d’unité qui est à l’intérieur de toutes choses. L’amour est une action et non une passion, dont la finalité est la justice, la condition dans laquelle l’unité est possible, l’accomplissement de toute vertu morale.
La connaissance et la droite conduite
Pour Proclus, enfin, la connaissance ne peut être atteinte qu’en reconnaissant les principes métaphysiques sur lesquels elle est fondée, et ces principes métaphysiques ont des équivalents éthiques. Si toutes les choses se dirigent vers le Bien, la connaissance va de pair avec la droite conduite, c’est-à-dire la culture des vertus, qui sont en vérité des niveaux de réalité et donc des pouvoirs. Le mal est quelque chose d’accessoire dans la recherche du bien, une limitation du processus.
La matière seule n’est pas la cause du mal, car la matière n’explique pas les différences d’inclination entre les âmes incarnées. La réalité de l’âme n’est pas affectée par le fait d’être incarnée, si elle a son habileté à exprimer sa nature essentielle. C’est pourquoi il faut de la discipline pour se débarrasser des liens de la souffrance dans le sens d’une privation de l’expression de l’âme.
Les âmes ne s’incarnent pas dans certaines circonstances par hasard, mais par leurs actions dans des vies antérieures, de telle sorte que chaque âme, en recevant ce qu’elle mérite, reçoit aussi ce dont elle a besoin et ce que les hommes appellent le destin n’est rien d’autre que la façon d’appeler les destinées des âmes dont les causes ne sont pas comprises.
Œuvres de Proclus
– Études et commentaires sur des dialogues platoniciens, tout à fait dans la ligne du néoplatonisme tardif : Parménide, Cratyle, Timée, La République, Alcibiade, Phédon, Gorgias, Phèdre, Théétète et Philèbe.
– Commentaires sur les Énnéades de Plotin
– Commentaires sur les Oracles chaldéen
– Commentaires sur Éléments de physique et Éléments de théologie
– Monographies sur Dix problèmes sur la providence, Sur la Providence et le Destin et Sur l’existence du mal
– Plusieurs traités religieux et théurgiques, dont il ne reste qu’un fragment intitulé Sur l’art hiératique des Grecs
– Une collection de sept hymnes