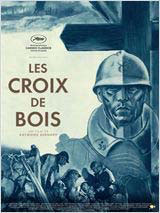Le salut d’Elon Musk

C’est en boucle qu’a circulé l’image d’Elon Musk saluant la foule le bras tendu durant un meeting du Président américain Donald Trump, donnant lieu à une kyrielle de commentaires virulents. Que nous apprend cette polémique ?
Tout d’abord, la variété des commentaires couvre un large spectre. Certains évoquèrent, en spécialistes, le salut romain, d’autres ont souligné les ressemblances corporelles entre le salut hitlérien et le bras de Elon Musk. Certains moins affirmatifs, ne manquèrent pas de noter que, même si le salut n’était pas strictement nazi, le soutien du personnage à l’extrême-droite de différents pays autorisait à l’assimiler au fascisme. D’autres, enfin, n’y voyaient qu’un geste maladroit et soulignaient l’engagement du personnage aux côtés d’Israël.
Info ou infox ?
Nul ne pourra sans doute pénétrer les véritables motivations du fantasque homme d’affaires, mais cette polémique nous invite à aller plus loin, pour tenter d’éclairer ce qui se trouve au-delà des apparences.
En premier lieu, remarquons qu’on ne voit que ce que l’on veut bien nous montrer. En effet, de nombreux commentateurs ont souligné que le geste était accompagné des paroles : « je vous remercie du fond du cœur » chose que la séquence entière semble confirmer, le montrant en train d’envoyer des cœurs à la foule. Une image muette et sortie du contexte pour lui faire dire ce qu’on veut lui faire dire, ne s’appelle pas de l’information, mais de la propagande.
L’habit et le moine
Ensuite on conviendra aisément que ce n’est pas parce que telle chose ressemble à telle autre, qu’elle a la même signification. L’habit ne fait pas le moine…
Revenons à l’exemple de ce salut. Il est employé dans différents contextes, comme les athlètes qui prêtent serment, ou les appelés à la barre du tribunal, ou les francs-maçons dans leurs cérémonies, ou encore les jeunes scouts. Sont-ils des nazis pour autant ? Non, assurément ! Car cette salutation, le bras droit levé et la paume face à l’autre, a une connotation sacrée et bienveillante dans de nombreuses traditions, comme le prouve, par exemple, la statuaire religieuse occidentale comme orientale, ou, encore aujourd’hui, le geste de la prise de serment du Président des États-Unis.
Arno Karlsfed, fils des célèbres « chasseurs de nazis » a lui-même déclaré : « cela n’était pas accompagné des cris nazis Heil Hitler… Le contexte et les mots qui entourent le geste, doivent être pris en compte. Ce n’est pas parce qu’on tend le bras dans un meeting que c’est un salut nazi. »
Reductio ad hitlerum
Alors pourquoi cet amalgame ? Il ne s’agit pas de voler au secours du nouveau chef du « Département de l’Efficacité gouvernementale » dont les positions extrêmistes ne peuvent être passées sous silence. Mais manifestement, l’emblématique patron de X a été victime de ce qu’on appelle la reductio ad hitlerum. De quoi s’agit-il ?
Pour faire simple, il a été démontré que, lorsque l’on veut insulter quelqu’un, très rapidement on en vient à le traiter de nazi. L’injure est aujourd’hui devenue un poncif pour tout ce que l’on veut discréditer. Il ne reste qu’à monter en épingle la moindre ambiguïté, un mot, un geste, une image sortis de leur contexte. Comme le dit le proverbe « qui veut noyer son chat l’accuse d’avoir la gale ».
Cette culture de l’anathème est malheureusement devenue monnaie courante dans le discours politique. Plutôt que des arguments de fond, on préfère la stigmatisation, plus rapide et imparable pour disqualifier l’adversaire.
L’effet pervers de la reductio ad hitlerum est d’affaiblir ce que l’on veut protéger. Si tout est nazi, rien n’est nazi. La banalisation à outrance contredit le nécessaire devoir de mémoire.
C’est ainsi que l’on voit, avec consternation, dans les derniers sondages, que 46 % des jeunes français entre 18 et 29 ans n’ont jamais entendu parler de l’Holocauste ou de la Shoah (1) et 33% des jeunes adultes pensent que les chiffres sont largement exagérés. C’est ainsi que la banalisation à outrance détruit le nécessaire devoir de mémoire.
La perte du symbolique
À l’origine de la perte du débat démocratique, et du dialogue comme partage d’idées, un phénomène culturel inquiétant est à l’œuvre. C’est la perte du mode symbolique. Le symbole est caractérisé par le fait d’englober de multiples sens. Il permet une pensée complexe parce qu’il intègre les paradoxes. Grâce à cela, il peut réunir les contraires.
La perte du symbolique a réduit l’esprit moderne aux significations univoques : de nos jours, telle représentation ne peut avoir qu’un seul sens, tel indice ne peut signifier que telle chose. C’est ainsi que les mots, les images, les symboles, les attitudes sont réduits à des significations d’autant plus arbitraires que la culture est faible et l’idéologie forte.
Ceci mène inéluctablement à une radicalisation de la pensée et à un éloignement toujours plus grand de la réalité. Les idées ne peuvent plus se rencontrer, mais seulement s’opposer, la recherche d’un point commun est remplacée par la violence des invectives. L’interprétation est prisonnière des apparences.
Nombreux sont ceux qui déplorent l’ère de la post-vérité, mais pour la combattre, il est nécessaire de la débusquer partout où elle se trouve : désinformation, culture de l’anathème, radicalisation de la pensée, banalisation des concepts, perte du symbolique.
Aussi, aujourd’hui plus que jamais, nous devons encourager l’exercice de l’esprit critique, au-delà de tout esprit partisan ou querelle idéologique.
Aujourd’hui, Il est temps de redécouvrir le pouvoir de la dialectique, ce dialogue entre deux logos, deux intelligences, qui recherchent ensemble le bien commun et la vérité. Aujourd’hui il est temps de redonner au mythos, la dimension symbolique son rôle de faire comprendre ce qui échappe à la rationalité. Aujourd’hui il grand temps de redonner à la philosophie la place qu’elle mérite.