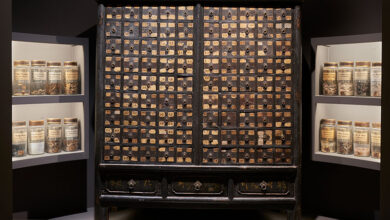« Zone d’intérêt », derrière la banalité, le tragique ?


Deux fois oscarisé, basé sur des faits réels, le film « La Zone d’intérêt » soulève une terrible question : le mal est-il banal ?
Sorti le 31 Janvier 2024 en France, le film « La Zone d’intérêt », adaptation du roman éponyme, relate des faits historiques en dépeignant le quotidien ordinaire de ceux qui orchestrèrent ou aidèrent à la mise en place d’une des plus grandes tragédies de l’Histoire, la Shoah. En posant la question : le mal est-il banal ? il nous invite à réactualiser la réflexion philosophique d’Hannah Arendt sur le sujet.
Co-exister avec le mal
Historiquement, la « Zone d’intérêt » est le nom que les nazis donnèrent à la zone de 40 km2 en périphérie du camp d’Auschwitz. Mais, dans le film, ce terme prend une tout autre dimension. Il fait référence à la grande maison, couplée à un formidable jardin, directement adjacents au mur du camp de la mort. C’est là où le commandant d’Auschwitz, Rudolf Höss, sa femme et leurs enfants réalisent leur vision d’une existence parfaite. Mais derrière l’apparence idyllique de la vie de famille, l’horreur dissimulée est omniprésente. Sans jamais la montrer directement, le réalisateur laisse au spectateur le soin d’imaginer, et cela fait toute la force de son œuvre qui tente, par ailleurs, de rendre fidèlement les détails historiques, incluant même les dialogues de la famille, rapportés ultérieurement par les prisonniers utilisés comme domestiques à son service.
Une réalité parallèle
Tout au long du film, la relation des personnages principaux au réel est biaisée. C’est avec le personnage de la femme de Rudolf Höss, Hedwig, véritable fil rouge du film, que nous sommes entraînés lentement à la frontière entre humanité et barbarie.
Ainsi, nous voyons l’épouse du commandant et mère de famille organiser des journées mondaines et des sorties bucoliques familiales dans la « zone d’intérêt ». Des vêtements de femmes brûlées dans le camp sont distribués comme récompenses à d’autres qui servent la famille. Un prisonnier exsangue vient livrer de la terre chez eux, terre qui lui sert à cultiver un jardin coloré et luxuriant, petit havre de paix. Le déni de réalité est saisissant. Enfermée dans son aspiration à une vie tranquille et normale, Hedwig vit comme une automate dans un monde parallèle, aveugle et sourde à la souffrance mitoyenne, vidée de toute humanité.
Lorsque sa propre mère lui rend visite et finit par fuir, horrifiée par ce qu’elle a compris d’Auschwitz, Hedwig se recroqueville dans sa bulle, se coupant de son propre lien de filiation pour ne pas remettre en cause son système de pensée et l’identité qu’elle s’est construite. Son mari, le commandant, est présenté dans une autre scène, avec des officiers et ingénieurs s’affairant pour rationaliser la mise en œuvre de la solution finale. Leur intelligence et leur savoir-faire sont asservis à une course aux résultats, dont dépendent leurs promotions, nominations, honneurs ou décorations, et, au final leur propre vie. Les prisonniers, quant à eux, sont devenus des chiffres, des quantités, des ratios, des taux de rendement des fours crématoires…
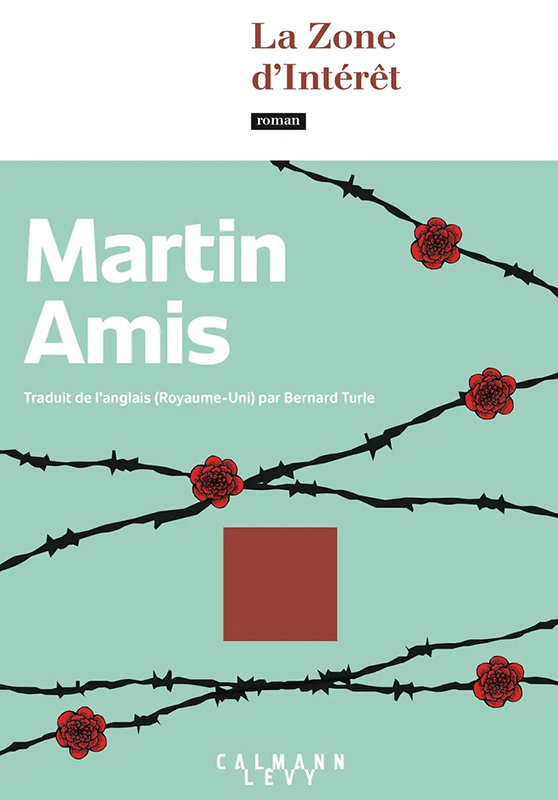
Le danger du déracinement intérieur
Dans ce monde glacé d’indifférence, la réalité prend des allures de fiction : l’apparence de normalité masque des comportements monstrueux. L’aspiration bourgeoise à une existence tranquille, émaillée de réussite professionnelle et sociale a effacé à la fois convictions et repères intérieurs. Par un chamboulement de la hiérarchie de valeurs, l’humain est passé en arrière-plan, faisant primer la vie personnelle sur la dignité humaine (la sienne et celles des autres). Toute dissidence de pensée est évacuée, il n’y a plus de débat ni de contradiction possible. L’absence de vie intérieure et d’exercice de conscience, substitués par la vie mondaine et professionnelle, empêche toute lucidité et retour en arrière. Les limites de la simple morale ont disparu. Et le conformisme d’une norme collective dans laquelle chacun s’inscrit (« tout le monde fait ça ») confère une ultime légitimité à l’inacceptable.
« C’est dans le vide de la pensée que s’inscrit le mal » écrit Hannah Arendt (1). Cette forme de léthargie de pensée est une aubaine pour le système totalitaire. En effet, la remise en question devient impossible. C’est par là que se met en place l’individu esseulé, atomisé, terreau du totalitarisme, comme le souligne la philosophe. Les hommes ne sont plus reconnus comme des hommes, et la barbarie advient à grande échelle.
Sortir de la zone de désintérêt
À l’aune de l’actualité nationale et internationale, ce film nous percute : l’histoire serait-elle une boucle où les égarements d’hier peuvent revenir aujourd’hui sous une autre forme, comme une condamnation à se répéter inexorablement ?
La leçon du film pourrait être de montrer le danger, pour tout un chacun, de devenir un monstre. Car Hedwig n’a rien d’une tueuse en série ou d’une lunatique paumée qui s’invente un monde. Et son mari, ainsi que les officiers et ingénieurs, sont visiblement animés par le désir de bien faire leur « travail » plutôt que par une idéologie mortifère, dont on entend à peine quelques propos.
Les psychologues, qui ont étudié la pathologie de la déshumanisation chez des médecins en situation de burn-out qui traitaient leurs patients comme des dossiers, concluent que, face à une réalité inacceptable et confrontée à l’impuissance de la changer, la psyché disjoncte et, pour survivre, n’a d’autre refuge que l’indifférence apathique ou le professionnalisme technique.
Autrement dit l’instinct de sécurité anesthésie l’âme. Pour satisfaire nos besoins matériels et ceux qui nous semblent vitaux, nous pouvons être prêts à abandonner la conscience morale qui fonde notre humanité. Comment nous prémunir de telles situations et nous assurer que le mal ne passera pas par nous ? Face à ce danger, que peut nous apporter la philosophie ?
Cultiver la pensée autrement
Comme nous le dit Hannah Arendt, le monstre est avant tout l’homme banal qui s’arrête de penser. La pensée est la grande affaire de la philosophie. La pratique de la philosophie, telle qu’elle était enseignée dans les écoles de philosophie classiques, dans la tradition desquelles se situe Nouvelle Acropole, invite à oser le « deux en un » socratique, c’est-à-dire le dialogue avec soi-même. Entamer un dialogue intérieur c’est se tenir debout sous la lumière de sa conscience et garder les yeux ouverts sur ce qui se passe autour de nous et dans le monde. C’est développer cette force intérieure indispensable pour refuser de détourner les yeux de ce qui nous dérange, pour accepter dans notre panorama mental une réalité douloureuse ou conflictuelle. Car la pensée n’est pas une question d’intelligence mais de courage ! Le contraire du mal dans sa banalité c’est « avoir une conscience aux aguets, entrer une dissidence intérieure, c’est un héroïsme ordinaire » écrit Jean Birnbaum (2). Concrètement nous pouvons nous exercer à regarder nos pensées, nos conduites et faire nos choix par ce dialogue afin de les transformer en actions et en engagements concrets.
Il s’agit donc de penser, non pas en conformité avec la majorité, mais avant tout, selon une conscience morale nourrie des grandes valeurs universelles qui ont fondé les civilisations. C’est oser la transcendance dans un monde matérialiste, force d’élévation intérieure sur le plan individuel et d’unité dans la diversité sur le plan collectif. Cela éloigne « l’homme de masse » en nous, celui qui se fond dans le moule de la société puisque « penser en soi est dangereux pour tous les crédos » (3).
Vivre en philosophe, c’est s’illuminer de l’intérieur, sortir de l’indifférence qui banalise l’indignité. C’est ouvrir la porte en soi pour retrouver la possibilité de faire société en se reliant aux autres et à la dignité qu’ils portent. « Nous devons vivre, et vivre ensemble, sur la simple force des promesses mutuelles d’une part et sur ce que l’on peut appeler la conscience de l’autre » (4). La philosophie est porteuse de tous les ferments d’humanisation qui ont élevé l’homme dans l’histoire. Elle est un patrimoine à chérir, chez tous les peuples et dans toutes les cultures. Son enseignement et sa pratique doivent être une priorité pour empêcher, entre autres, l’être humain de détourner les yeux des atrocités qui se déroulent dans le monde, en succombant aux charmes des sirènes du confort ou au désespoir de l’impuissance, mais aussi de l’engager à les combattre au nom des plus nobles idéaux.