2017, la crise du temps
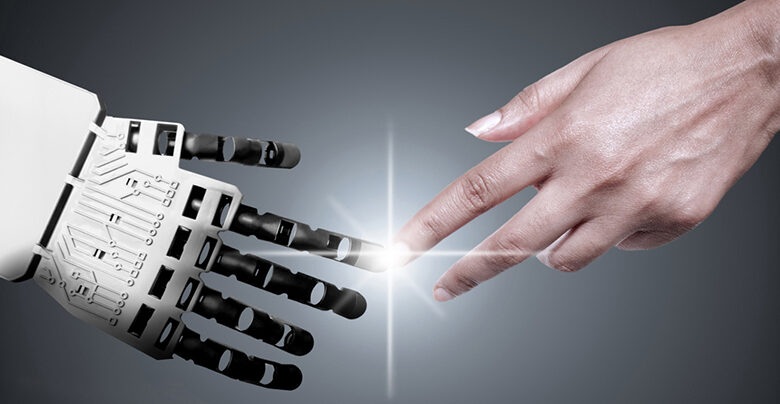
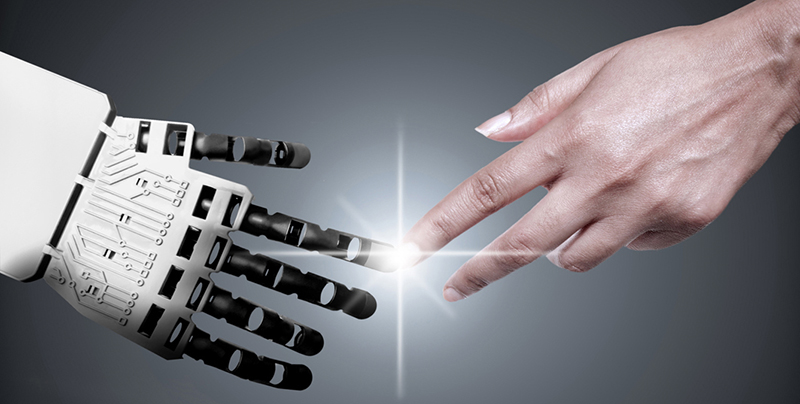
Nos démocraties occidentales présentent des signes de grande anxiété, de peur et de colère, qui montent des classes moyennes. Une incompréhension manifeste se produit entre les élites et les peuples.
La clé économique ne permet pas d’expliquer l’ensemble de ce phénomène, puisqu’il se produit même dans des pays où l’économie affiche une santé excellente, comme c’est le cas aux Pays-Bas, où malgré tout, monte la xénophobie.
La déstabilisation des sociétés est assez flagrante car plusieurs démocraties ont vu la destitution de leur président par la rue, écœurées par la corruption et les mensonges des régimes forts qui résistent en diminuant les libertés et en pratiquant la répression et la démagogie.
Reprenant les vieilles ficelles des sophistes que Platon avait déjà dénoncés, beaucoup, dans la classe politique sont tentés de suivre cette pente. Platon leur avait reproché trois choses qui semblent assez actuelles :
– Il ne suffit pas d’être un bon communicant pour diriger une cité. Encore faut-il avoir des idées et un projet.
– Le relativisme allié à la liberté conduit la démocratie vers la tyrannie. Car la relativisation des erreurs et des mensonges empêche de porter un regard critique sur la tyrannie.
– Le vrai doit l’emporter sur l’agréable et non l’inverse, la vie facile mue par la quête du plaisir entraînant toujours l’égoïsme et les mensonges.
Comment en sommes-nous arrivés là ?
Trois pistes semblent se conjuguer. Deux sont assez connues : la première, celle de l’épuisement et de la désintégration de nos systèmes démocratiques, incapables de se renouveler, comme si l’on était arrivé à la fin d’un cycle idéologique, laissant le champ libre au populisme et aux solutions identitaires extrêmes. L’autre, celle de la mondialisation et des crises qui ont déstabilisé les identités ainsi que les imaginaires et les représentations sociales qui perduraient depuis des siècles, encourageant le retour au protectionnisme de tout ordre.
Thomas L. Friedman, triple prix Pulitzer nous en propose une troisième : nos démocraties occidentales vivraient d’abord et avant tout une crise du temps et celle-ci se reflète notamment dans le domaine des formes du travail, qui, depuis dix ans, ont connu des mutations multiples. Cette « grande transformation », explique-t-il, « déstabilise et angoisse un bon nombre de la population ». Dans son livre (1), il souligne l’importance de l’année 2007, expliquant qu’il s’est produit une révolution équivalant à celle de la fin du XVe siècle, avec l’apparition de l’imprimerie de Gutenberg.
L’année 2007 commence bien. Dès le 9 janvier, Steve Jobs annonce qu’Apple vient de réinventer le téléphone mobile. Dans son sillage, sans évidemment se mettre d’accord, un faisceau d’entreprises innovantes transforment la manière de communiquer et de collaborer entre les individus et les machines. Hadoop décuple la capacité de stockage des ordinateurs. Google lance un droïde et son propre système d’exploitation. AIRBNB naît à San Francisco. Amazon commercialise les Kindle. IBM développe un ordinateur cognitif Watson, capable d’associer un apprentissage de haut niveau et une intelligence artificielle. Facebook et Twitter accèdent à la dimension mondiale. L’éclairage aux led et la voiture électrique décollent de manière exponentielle. Les biotechnologies profitent de l’explosion des puissances de calcul et de stockage des ordinateurs. Friedman parle d’une « grande bascule ». Il signale trois accélérations majeures : celle du marché par la globalisation ; celle de Mère nature à travers le changement climatique ; et la loi de Moore : datant des années 60, elle explique que la puissance des ordinateurs allait croître de manière exponentielle pendant des années et cette croissance est arrivée en 2017 à une limite physique, celle de la taille des atomes.
Toutes ces nouveautés auraient peut-être être assimilées et conscientisées par le grand public, mais en 2008, s’est produite la grande crise économique et financière qui a déstabilisé les gouvernements pendant de longues années. Ces derniers n’étaient pas du tout préparés à faire face à la crise et ainsi, toutes ces technologies et inventions nouvelles n’ont pas pu être canalisées par les systèmes éducatifs et de formation, car l’univers politique s’est gelé et disloqué. Les vrais enjeux furent occultés par la crise.
Dix ans plus tard, avec du recul, nous commençons à être conscients de tous ces bouleversements, au niveau des formes de travail mais également de la pédagogie et de l’éducation, qu’il faut mettre en place pour les assimiler. « Beaucoup ont de plus en plus l’impression de perdre les pédales : nous ne savons pas nous adapter à la vitesse à laquelle le monde change. […] Il y a une dissymétrie entre l’accélération du rythme du changement et notre capacité à inventer les systèmes d’apprentissage, de formation, de management, les amortisseurs sociaux et les régulations qui permettraient aux citoyens de tirer le meilleur de ces accélérations tout en atténuant leurs pires effets ».
La guerre des mots se joue aujourd’hui entre ceux qui proposent la formule du mur (fermer tout aux frontières) et ceux qui prônent l’ouverture. Pour la réussir, Friedman conseille de travailler à « muscler la résilience des sociétés » et celle-ci dépend à 90 % de l’optimisation de l’apprentissage.
Comme les philosophes anciens l’avaient déjà préconisé, le monde politique et économique devrait davantage comprendre que la clé de l’équilibre pour danser dans l’œil du cyclone, c’est l’éducation.




