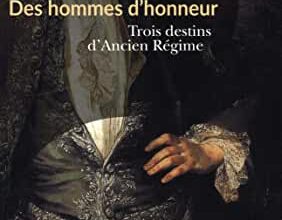Raconte, grand-mère, mon village sous l’occupation allemande (2)

L’auteur raconte ses souvenirs de la vie quotidienne sous l’occupation allemande.

Un des bons souvenirs était la saison des champignons.
Aux champignons
Quand c’était la saison, nous allions en forêt chercher des champignons. Mon père les connaissait bien et savait où les trouver. Nous revenions avec des paniers où se mêlaient girolles, pieds de mouton, trompettes de la mort, coulemelles, cèpes de diverses espèces et parfois, ô merveille, quelques oronges, rares dans notre région, les plus succulentes et les plus belles avec leur chapeau orange vif, le bel anneau jaune autour leur pied et la membrane blanche qui les enveloppe quand elles sont jeunes et qu’elles font éclater en grandissant.
On en faisait cuire à la poêle, on en farcissait parfois une omelette. Et on se régalait. Mon père nettoyait le reste et les enfilait à l’aide d’une grosse aiguille sur une longue ficelle mince qu’il suspendait, d’un mur à l’autre, pour les faire sécher, au plafond de la cuisine, la seule pièce chauffée de la maison, grâce au fourneau à bois sur lequel cuisinait ma mère. Il y en avait parfois plusieurs et nous avions ainsi, tissée au-dessus de nos têtes, une décoration inédite qui embaumait la pièce. Une fois bien secs, on les conservait dans des bocaux qu’on pouvait ensuite cuisiner à volonté.
L’art de la débrouille
Bien d’autres produits manquaient, en dehors des produits alimentaires. Ainsi le cuir, réquisitionné pour l’armée allemande.
Je vois encore mon père, ressemelant les sandales que nous portions en été, avec des morceaux de vieux pneus. L’hiver, on entendait régulièrement, à la rentrée et à la sortie de l’école, claquer dans la rue le concert des galoches à semelles de bois que nous, les enfants, portions tous. Sauf le jeudi car, alors, c’était le jeudi qu’il n’y avait pas d’école. Ce n’est qu’en 1972 que le jeudi fut remplacé par le mercredi. D’où l’expression, « la semaine des quatre jeudis », autant dire jamais, « à la Saint-Glinglin » ou « quand les poules auront des dents ».
Les chambres à air manquant, beaucoup de bicyclettes avaient des pneus pleins, une fois la chambre définitivement hors d’usage, couverte de rustines après d’innombrables crevaisons : bien des routes alors, n’étaient pas goudronnées ou peu entretenues.
Ma mère me cousait robes et jupes – à l’époque, les filles ne portaient pas de pantalons – qu’elle taillait dans des vêtements à elle qui dataient d’avant-guerre. Combien de fois l’ai-je entendu dire : « Ah ! si j’avais su, j’aurais gardé telle ou telle chose ». Marquée par cette réflexion, j’en ai gardé une difficulté à jeter : « On ne sait jamais ! Cela pourrait servir. »

Jour de lessive
C’est jour de lessive. Nous sommes six et ce n’est pas une mince affaire, d’autant qu’aujourd’hui on lave les draps. De bon matin, ma mère a allumé le feu dans la cheminée du sous-sol et mis à chauffer de l’eau dans le grand chaudron en fonte, avec de la cendre et parfois des poignées de saponaire, appelée aussi herbe à savon, plante aux fleurs rose pâle que nous avons cueillies sur les talus au cours d’une promenade. Car le savon, lui aussi, est rationné. Ma mère en recueille soigneusement les petits restes et les fait fondre pour faire un nouveau savon.
Aidée d’une femme du village qui vient plusieurs fois par semaine, elle descend les draps, lourds et encombrants car ils sont en toile. Elles les mettent dans le chaudron et poussent le feu car le linge doit bouillir. Régulièrement, avec un bâton, elles remuent et renfoncent le linge dans l’eau. Quand il a suffisamment bouilli, elles le sortent du chaudron et le frottent énergiquement sur une planche avec des brosses en chiendent puis le rincent avec l’eau qu’elles vont chercher au puits, qui est tout près, dans le jardin. Enfin, elles étendent les draps sur les fils à linge installés dans le jardin et dans le sous-sol. En hiver, quand il gèle, les draps qui sont dehors gèlent aussi, ils deviennent alors tout durs et il faut faire attention à ne pas les plier car ils sont cassants et pourraient se déchirer. On attend pour cela qu’ils aient dégelé.
Lorsqu’il fait beau en été – vieille tradition – on les étale sur la pelouse où ils passent la nuit car la lumière de la lune, plus encore quand elle est pleine, blanchit le linge.
Les premiers hivers des années 40 furent très froids. La seule pièce de la maison vraiment chaude est la cuisine. Le soir, chacun monte avec sa bouteille d’eau chaude pour réchauffer ses draps glacés. Cela ne nous empêche pas d’avoir des engelures. Et, dans la journée, lorsque nous sommes restés longtemps dehors sans nous méfier, d’attraper l’onglet. Nos doigts deviennent tout blancs et en se réchauffant brûlent douloureusement.
Chevaux et maréchal-ferrant
Les chevaux faisaient partie de nos vies. Tous les fermiers en avaient un ou plus. Le tracteur ne s’est répandu qu’après la guerre. Il passait souvent devant chez nous des chevaux qui tiraient charrettes ou outils agricoles. Ma mère, quand on les entendait passer, nous envoyait vérifier si les chevaux avaient laissé du crottin sur leur passage et, lorsque c’était le cas, elle allait, avec une pelle et un seau, le ramasser pour le répandre dans le potager car le crottin de cheval est un excellent engrais naturel.
En haut de la côte, juste avant l’église, se trouvait l’atelier du maréchal-ferrant. Une grande pièce sombre où brûlait en permanence un feu alimenté avec du charbon et qu’on attisait à l’aide d’un énorme soufflet. Devant une enclume, de dos, une silhouette noire sur fond de flammes et de braises rougeoyantes, pareille à un sorcier puissant et ténébreux : c’est le maréchal-ferrant. Il porte un grand tablier de cuir. Dans sa main gauche, une énorme pince avec laquelle il s’empare d’un fer à cheval chauffé au rouge dans le brasier. Dans sa main droite, un lourd marteau dont il frappe à grands coups, pour le modeler selon les besoins de chaque sabot, le fer d’où jaillissent des jets d’étincelles.
Il a d’abord nettoyé le sabot du cheval qu’il prépare ensuite en le rognant avec un couteau aussi coupant qu’un rasoir. Lorsqu’il pose le fer brûlant sur le sabot, se dégage un nuage de fumée qui sent la corne brûlée. Puis il le fixe à l’aide de gros clous. C’est fascinant et effrayant. On a beau me dire que cela ne fait pas souffrir le cheval qui, effectivement ne bouge pas, je n’arrive pas à le croire.
par Marie-Françoise TOURET
formatrice à Nouvelle Acropole
© Nouvelle Acropole