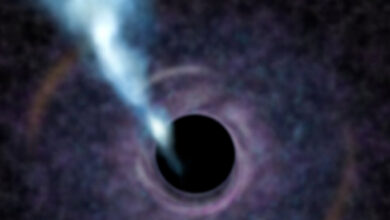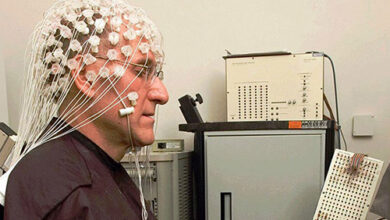Comment les plantes communiquent

C’est en 1983 que des chercheurs ont pour la première fois clairement démontré que les plantes pouvaient communiquer entre elles par des signaux chimiques, une découverte fondamentale qui a ouvert la voie à un champ de recherche entièrement nouveau.
Le végétal possède un réseau de communication très sophistiqué.
La communication végétale s’opère à travers divers moyens : signaux chimiques et électriques, modifications physiques, et même interactions souterraines par l’intermédiaire de leurs racines et réseaux de mycorhizes (du grec « myco » pour champignon et « rhize » pour racine). Ces échanges d’informations ne se limitent pas à l’individu isolé, mais s’étendent à des communautés de plantes, révélant un niveau d’organisation et de coopération étonnant.
Les plantes appellent à l’aide grâce aux odeurs
Les plantes ont développé des stratégies ingénieuses pour attirer les pollinisateurs et repousser les herbivores, jouant ainsi un rôle actif dans leur relation avec le monde animal.
Lorsqu’une certaine plante se sent en danger, elle produit une odeur (1) en signal de détresse. Par exemple, lorsque des guêpes sentent la détresse de la plante, elles tournent autour d’elle pour identifier les chenilles, puis elles les attaquent. Les composés volatils servent aussi de signal d’alarme à d’autres parties de la plante ou même à d’autres plantes voisines. Ces signaux peuvent induire des réponses défensives, comme la production de substances toxiques ou répulsives pour les herbivores.
L’un des exemples de communication chimique interplantes le plus connu et le plus souvent relaté est la communication aérienne des acacias, attaqués par les koudous (sortes d’antilopes) d’une réserve africaine. Certains animaux ont été retrouvés morts, empoisonnés, après avoir mangé les feuilles des arbres. Les acacias déclenchent un signal en libérant des substances volatiles (comme l’éthylène ou le jasmonate de méthyle) dont la fonction est d’avertir de la menace, l’ensemble de leur feuillage, y compris les autres plantes de la même espèce, situées à proximité. Les feuilles se chargent de tanins et sont rendues indigestes, voire mortelles, pour un éventuel prédateur.
Les plantes communiquent également par des signaux électriques
Les plantes sont capables de capter des stimuli lumineux ou tactiles et de déceler leurs variations d’intensité, leur orientation ou leur concentration grâce à l’ensemble de leur surface, aptitude assez similaire à notre sens du toucher réparti sur tout notre corps.
La plante sensible (Mimosa pudica) nous donne un exemple intéressant. Lorsque nous touchons cette plante, elle bouge et ses feuilles se replient.
Des signaux électriques peuvent se propager à travers la plante pour déclencher des réponses rapides, comme la fermeture des stomates (1) en réponse au stress hydrique.
Les végétaux possèdent en effet des cellules réceptrices de signaux externes sur toute leur surface aérienne et racinaire. De plus, les plantes sont aussi sensibles à des variations de gravitation ou d’électromagnétisme que nous ne percevons pas. L’information est, en un sens, intégrée au niveau cellulaire et diffusée chimiquement par le système vasculaire sans être centralisée nerveusement et cérébralement.

La communication entre les racines des plantes
Les racines des plantes ne servent pas uniquement à l’absorption de l’eau et des nutriments ; elles jouent également un rôle majeur dans un système de communication complexe et peu visible.
La communication racinaire implique des échanges d’informations entre les racines des plantes, permettant une coordination et une coopération remarquables. Les racines sécrètent une variété de composés chimiques dans le sol, y compris des hormones, des signaux d’alerte et des substances nutritives.
Ces exsudats racinaires peuvent affecter la croissance et le comportement d’autres plantes à proximité, ainsi que la composition microbienne du sol, en vue d’éviter la compétition pour les ressources ou, au contraire, de s’entraider dans des environnements difficiles.
Wood Wide Web
De plus, des champignons symbiotiques s’associent aux racines des plantes pour former des mycorhizes ou réseau mycorhizien. Chez certains arbres (le pin, par exemple), les parents reconnaissent les jeunes plants qui poussent à leur pied et leur fournissent, par l’intermédiaire de leurs racines et des mycorhizes qui font office de réseau de communication, des nutriments (sucres) afin de compenser le manque de lumière du sous-bois. D’autres plantes vont libérer des substances qui inhibent la croissance des racines des plantes voisines.
Lorsqu’une plante est attaquée par des pathogènes ou des herbivores, elle peut envoyer des signaux chimiques via le réseau mycorhizien, alertant ainsi les plantes voisines qui peuvent alors activer leurs propres défenses. Chez la plupart des plantes terrestres, la mycorhization est la règle et favorise l’équilibre des écosystèmes. Certains ont qualifié ce réseau mycélien de Wood Wide Web, ou « Internet de la forêt ».
Les plantes émettent des ultrasons et seraient sensibles aux bruits
« Dans la nature, on sait que les variations de bruits peuvent renseigner les plantes sur la présence ou non d’un prédateur », explique Olivier Gallet, directeur du laboratoire ERRMECe, de l’université de Cergy-Pontoise.
D’autre part, certaines fleurs augmentent leur production de nectar en fonction de la présence du bourdonnement des pollinisateurs pour mieux les attirer.
Selon la société Genodics, la musique provenant d’enceintes placées dans des parcelles cultivées, favorise la croissance des plantes et leur résistance à la sécheresse et aux champignons.
Plasticité comportementale
La communication au sein du vivant ne résulte pas seulement d’un programme génétique déterminé par la sélection naturelle, mais témoigne aussi d’une plasticité adaptative et comportementale des organismes à un niveau épigénétique, qui est elle-même fonction des circonstances auxquelles ils sont confrontés.
Parler de communication chez les plantes, et plus généralement au sein du vivant, s’avère donc légitime dans la mesure où les fonctions et les finalités de la communication biologique ne sont ni dues au hasard ni entièrement déterminées, programmées et invariables, comme le serait une machine ou une réaction à un stimulus de type réflexe.
Ainsi les plantes communiquent et ont leur propre sensibilité avec plusieurs sens à leur disposition pour interagir avec leur environnement.
Ceci nous rappelle, comme l’affirmaient les anciens philosophes, que, dans l’univers, tout ce qui est vivant est porteur d’une forme de conscience, même si seul l’être humain est auto-conscient. C’est pourquoi les traditions spirituelles ont engagé l’homme à un respect du vivant sous toutes ses formes.
Ces récentes découvertes confirment également la prééminence de la coopération au sein d’une espèce, comme entre les espèces, pour développer protection et résilience face aux menaces. Elles battent en brèche les théories du darwinisme qui ont fait prévaloir la compétition et la lutte pour la survie comme facteurs clés de l’évolution. Bien au contraire, elles confirment ce que, de tous temps, les écoles de philosophie ont défendu, à travers l’amitié philosophique (philia) : l’union rend plus fort et la fraternité est le plus puissant moteur d’évolution individuelle et collective.