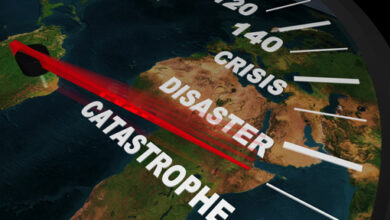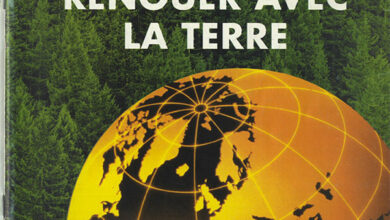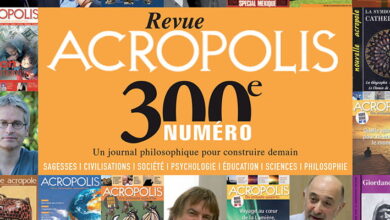L’égalité est-elle à notre portée ? Voici une question actuelle alors que nous ne pouvons que constater l’augmentation des inégalités économiques sociales au cours des dernières décennies.
Il existe aujourd’hui de nombreuses façons définir l’égalité : égalité entre les races, entre les sexes, égalité des chances, égalité économique, juridique, entre autres. L’égalité, en particulier économique, est considérée comme souhaitable mais difficile à atteindre, notamment à travers l’apparition de systèmes économiques dominants tels que le capitalisme et le communisme.
Le communisme, comme modèle pratique d’organisation politique, économique et sociale, inspiré des idées de Karl Marx, aspirait à réaliser l’égalité des classes sociales en éliminant la propriété privée des moyens deproduction. En pratique, la plupart des régimes communistes se sont transformés en dictatures à parti unique. Ils ont créé de nouvelles élites politiques et économiques, intensifiant ainsi les inégalités, limitant les libertés fondamentales (liberté d’opinion, de circulation, de pensée et de religion). Ils ont imposé par la force une conception de l’égalité qui contredit la liberté individuelle de choisir ses propres finalités et valeurs.
Comme le dit le philosophe Jorge Angel Livraga, fondateur de Nouvelle Acropole dans le monde : « Face à l’égalité inventée, on a perdu l’échelle des valeurs qui par ses marches naturelles nous permet de monter et même d’avoir la liberté de descendre. Il n’y a rien de plus contraire à la liberté que l’égalité » (1).
En même temps, le capitalisme mondialisé a contribué à la concentration des richesses entre les mains de quelques-uns, créant de grandes disparités entre les classes sociales et entre les pays riches et les pays en développement, comme le démontrent les écarts toujours plus grands entre les individus les plus riches et les plus pauvres.
Ces deux systèmes, le libéralisme et le marxisme, ont en commun la conception d’une organisation sociale fondée principalement sur l’économie, sur la distribution des biens matériels comme moyen d’atteindre le bien-être et le bonheur de l’homme. Cette vision matérialiste globale de la vie réduit les principales aspirations de tous les êtres humains à la réalisation de conditions de vie matérielles égales pour tous, sans tenir compte de la diversité des capacités, des aspirations et des libertés individuelles ni de la pluralité des façons de comprendre et de vivre la vie.
Le mythe de Procuste : l’homogénéisation de la diversité
Ces dernières décennies ont été marquées par une tendance à l’homogénéisation de l’être humain, reflétée dans le mythe de Procuste (2).
Dans les systèmes éducatifs, cela se traduit par la tendance à uniformiser les élèves, sans tenir compte de leurs caractéristiques particulières ; à produire des individus en série qui apprennent les mêmes choses au même rythme, se conforment aux normes et comportements attendus. Il n’y a plus de liberté ni d’individualité.
D’autre part, la mondialisation, bien qu’elle ait favorisé les échanges culturels et l’interconnexion entre les personnes, produit également au niveau mondial une homogénéisation des sociétés. Dans de nombreuses régions du monde, des coutumes et des valeurs des pays économiquement, technologiquement et politiquement dominants, s’imposent et se popularisent, notamment dans le cinéma et la télévision et les réseaux sociaux. On observe une diminution des particularités locales et de la diversité culturelle.
Il est donc utile de revoir ce que l’on entend par égalité.
Que signifie être égaux ?
Avoir les mêmes droits, opportunités ou résultats ? Est-ce l’égalité naturelle ou une construction sociale ?
Étymologiquement, le mot égalité vient du latin aequalitas et signifie : « une situation dans laquelle une chose est conforme à une autre chose ».
Jorge, Angel Livraga dit : « Il est facile d’en déduire que l’égalité est une propriété acquise par la comparaison d’une chose avec une autre et non une propriété de la chose en soi. Il n’y aurait donc ni être ni chose qui puisse être égal sans l’aide de l’autre ; ce n’est pas une qualité naturelle, mais une qualité qui provient des circonstances. L’égalité, comme toutes les propriétés acquises, est dépendante » (3).
Les religions nous parlent d’une origine commune pour tous les êtres humains, ce qui implique une égalité essentielle en termes spirituels et moraux. Le bouddhisme, par exemple, enseigne que toutes les personnes ont la capacité d’atteindre l’illumination.
Les stoïciens, quant à eux, considèrent que les êtres humains partagent la capacité de raisonner et sont soumis au même ordre naturel.
Cependant, dans le monde dans lequel nous vivons, « l’expérience quotidienne nous enseigne, de manière irréfutable, qu’il n’y a pas deux feuilles d’arbre identiques, ni deux visages humains identiques, ni une seule chose identique par rapport à une autre » (4). Par exemple, il n’y a pas deux personnes qui aient des empreintes digitales identiques. Chaque individu d’une espèce possède un génome unique. De même, chaque flocon de neige est unique dans sa structure moléculaire, même si à première vue ils paraissent similaires. Ainsi, la nature nous montre que, dans le meilleur des cas, nous pouvons trouver des ressemblances, mais jamais une similitude absolue.
Bien qu’il existe certains éléments universels, tels que les lois physiques et les processus biologiques fondamentaux, la variabilité est inhérente à la vie. La nature ne cherche pas l’égalité, mais l’équilibre qui résulte de l’interaction d’éléments inégaux qui se complètent.
L’égalité en termes humains
L’égalité en termes humains est davantage une idée éthique et politique qu’une caractéristique inhérente au monde naturel.
La Déclaration d’indépendance des États-Unis (1776) et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) de la Révolution française ont fait de l’égalité un principe fondamental. Mais ce n’est qu’en 1948 que le droit à l’égalité a été institutionnalisé dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies.
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité » (article 1).
« Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente Déclaration, sans distinction aucune de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation » (article 2).
Comment mesurons-nous l’égalité ?
La façon la plus courante de mesurer le niveau d’inégalité sociale a été de mesurer l’écart entre les riches et les pauvres, réduisant ainsi le problème à la sphère économique.
Par exemple, on a utilisé des indicateurs conventionnels tels que le Produit Intérieur Brut (PIB) par habitant pour mesurer le bien-être social dans les différents États. Cependant, cet indicateur ne tient pas compte de la répartition de la richesse en attribuant des valeurs élevées à des nations présentant de profondes inégalités. Il ne prend pas non plus en compte la riche pluralité de la vie humaine, qui ne peut être mesurée de manière homogène par un seul indicateur.
Plutôt que de parler d’égalité matérielle, il semble plus approprié de se référer à l’égalité des chances : s’assurer que toutes les personnes aient les mêmes possibilités de développer leur potentiel et d’atteindre leurs objectifs. Cela inclut l’égalité d’accès à une éducation de qualité, à l’emploi, aux services de santé et au logement, ainsi que l’élimination des obstacles structurels tels que la discrimination ou l’exclusion.
Le modèle connu sous le nom d’Approche par les Capacités (AC), développé et défendu par Amartya Sen ainsi que par la philosophe américaine Martha Nussbaum, approfondit encore la recherche d’une véritable justice sociale. Il met l’accent sur les capacités de faire et d’être d’une personne, favorise le respect des possibilités de choix ou d’autodéfinition des personnes et s’attaque également à l’injustice et aux inégalités sociales, en assignant aux États la tâche d’améliorer la qualité de vie de toutes les personnes.
L’AC ne se réfère pas seulement aux capacités intérieures d’une personne, mais comprend également les libertés et les opportunités créées par la combinaison des capacités personnelles avec l’environnement politique, social et économique.
Pour promouvoir les capacités humaines, une société doit soutenir le développement des capacités intérieures par l’éducation, la promotion de la santé physique et émotionnelle, le soutien familial et de nombreuses autres mesures, comme assurer les besoins fondamentaux (être bien nourri et en bonne santé) et rechercher le bonheur, la dignité et la participation sociale.
L’équité comme complément à l’idée d’égalité
La conception actuelle de l’égalité ne cherche pas à homogénéiser ou à éliminer les différences individuelles, mais à faire en sorte que ces différences ne se traduisent pas par des avantages ou des désavantages systématiques. Selon cette idée, nous tous avons la même valeur et méritons une vie digne, mais nous ne partageons pas tous les mêmes conditions, possibilités ou capacités pour atteindre notre bien-être ou la garantie de nos droits en tant que citoyens. Parce que nous sommes différents, nous devons parfois être traités différemment.
D’où le concept d’équité comme complément de l’égalité. L’équité reconnaît les caractéristiques et les conditions individuelles et sociales afin de garantir que l’application de l’égalité soit juste.
Par exemple, l’égalité consisterait à donner à tous le même type d’échelle pour atteindre les branches d’un arbre. L’équité consisterait à réaliser que tous ne peuvent pas utiliser la même échelle et à leur fournir un autre moyen d’atteindre les branches de l’arbre.
L’équité consiste à apporter un soutien plus important à ceux qui en ont le plus besoin, afin d’égaliser les chances plutôt que de distribuer les ressources de manière uniforme. Un exemple d’équité est la garantie de conditions et d’opportunités permettant aux enfants et aux jeunes ayant des besoins particuliers, tels que des handicaps visuels, auditifs, moteurs ou intellectuels, d’accéder pleinement à l’éducation.
Ainsi, l’idée d’égalité passe par une reconnaissance de la diversité au sein de l’égalité. Le rajout des capacités et de l’équité, implique directement la reconnaissance de la diversité et de la pluralité humaines, en s’éloignant de la simple distribution uniforme des ressources ou des droits pour tous. Ces propositions reposent sur une conception plus large et inclusive de l’être humain et de la société.
Jorge Livraga souligne : « Le fait que nous soyons différents les uns des autres ne signifie pas que nous valons moins ou plus […]. Nous sommes tous merveilleusement différents […]. Nous sommes différents et irremplaçables, et même si nous acceptons la théorie de la réincarnation, nous ne serons jamais exactement les mêmes, car si l’esprit est identique en soi, son environnement ou ses véhicules ne peuvent pas l’être » (5).
Le grand défi de nos sociétés modernes est donc d’établir un cadre normatif qui allie diversité, liberté et fraternité. Bien que nous soyons loin d’atteindre cet idéal, il est indispensable de construire les fondements théoriques et les archétypes qui nous orientent vers la création de sociétés plus justes et égalitaires, basées sur les concepts modernes d’égalité et d’équité.
C’est ce à quoi s’emploie notre école de philosophie Nouvelle Acropole dans ses 500 centres dans le monde.