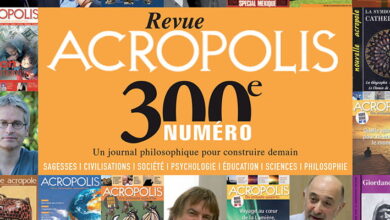Éditorial : À quoi sert la musique ?

« La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. » Nietzsche (1)
Aujourd’hui, omniprésente, dans nos vies, la musique est partout, dans les salles de concert certes, mais bien plus souvent dans les écouteurs, les supermarchés et jusqu’aux ascenseurs. Perçue par le plus grand nombre comme loisir ou divertissement, la musique possède pourtant un pouvoir bien plus grand, celui de nous permettre de nous toucher au plus profond, au-delà des mots, en nous sortant de nos étroitesses et de nos rigidités mentales.
Dans un monde saturé d’intellect, où tout est calculé, contrôlé, la musique parvient encore à faire des miracles. Dépassant les limitations des pensées trop étroites, élevant les consciences, éveillant les cœurs, elle résiste et fait vibrer la corde de l’âme à des réalité plus subtiles, inutiles au sens utilitaire, mais essentielles au sens existentiel.
Mais cette puissance de la musique peut être détournée et devenir un outil de manipulation émotionnelle.
Comme le montre une étude récente publiée par Le Point, (2) la musique qui passe dans les supermarchés est loin d’être innocente. Elle vise à modifier notre comportement de consommateur. La musique classique donnant l’impression d’un cadre plus luxueux, est utilisée pour inciter à dépenser davantage, tout comme les chansons de Gainsbourg ou de Piaf sont utilisées pour doper les ventes de vin français. La musique, ici, est utilisée à des fins de rentabilité, dans une logique marketing froide, déconnectée de toute visée esthétique ou éthique. Ce n’est pas un phénomène nouveau.
Dès les années 1930, l’entreprise américaine Muzak vendait de la musique d’ambiance pour calmer les passagers des ascenseurs. Mais, quand le simple choix d’une playlist devient levier économique, la musique n’est plus un art, mais un outil. Elle ne cherche plus à éveiller, mais à vendre. Elle n’est plus offerte, mais utilisée dans une forme de démesure qui transforme en marchandise jusqu’au plus sacré. Platon savait ce qu’il disait quand il affirmait dans La République : « Quand les formes de la musique changent, les lois fondamentales de l’État changent avec elles… ».
Car la musique comme art véritable est un authentique chemin d’élévation, qui permet d’entrer dans un espace où l’intellect se tait et où la conscience s’ouvre à autre chose. Cette expérience n’est pas seulement individuelle, elle peut devenir sociale, collective, civilisatrice comme dans le projet Démos, de la Philharmonie de Paris (3). Des enfants, souvent éloignés de la culture classique, des familles pour qui Mozart ou Bach sont des noms d’une autre planète, entrent dans un orchestre, et sans mots, apprennent à respirer ensemble, à écouter, à être en lien, à créer une œuvre commune. La musique devient alors vecteur d’unité, d’égalité, d’intelligence collective.
C’est peut-être cela, ce que les Anciens appelaient civilisation, cet étrange lien qui relie des personnes qui ne se connaissent pas, comme si elles étaient de la même famille. Pour eux, l’art permettait une catharsis, une purification.
Et si c’est dans la musique, plus que dans toute autre forme artistique, que cette tension est la plus forte, la plus évidente, c’est parce que la musique ne montre rien. Elle fait sentir, mais n’explique rien. Elle nous touche, nous relie, à nous-mêmes, aux autres, à quelque chose de plus grand.
Oui, la musique touche le cœur, oui, la musique est capable de nous faire voir un sens au-delà du chaos.
N’oublions pas qu’il existe un lien profond entre l’art et la philosophie. Si le philosophe est celui qui cherche l’archétype, l’idée pure, la forme immuable derrière les apparences du monde, l’artiste est celui qui nous permet de monter à l’échelle, de parvenir jusqu’à l’archétype pour toucher une autre réalité. C’est pour cela que malgré tout, la musique résiste.
Comme le dit la Canadienne Keri-Lynn Wilson, chef d’orchestre de l’Ukrainian Freedom Orchestra (4), formation composée d’artistes originaires d’Ukraine qui jouent pour lutter avec leurs armes contre la guerre : « La musique agit comme un effet cathartique, un soulagement ». Car elle nous permet par la beauté de résister à l’horreur comme à la bêtise, à la platitude, comme à l’uniformité, ou à la manipulation, parce qu’elle nous parle au cœur. Et parce qu’aucune stratégie marketing, aucun algorithme ne pourra jamais jouer la musique de l’âme. Comme le dit si justement le pianiste Lang Lang (5) : « Ce n’est pas un remède, mais une consolation. Nous avons besoin d’une musique qui vous touche au plus profond de l’âme. Il n’y a rien de plus puissant pour cela que la musique de Bach. ».
La musique et la philosophie ont ceci en commun, elles ne cherchent pas à exploiter, mais à éveiller. Elles ne divisent pas, elles relient. Elles ne vendent pas, elles transmettent. Et tant que des artistes continueront à tendre la corde de leur âme, tant que des philosophes continueront à chercher l’archétype, alors la musique continuera d’être ce qu’elle a toujours été, l’écho sensible de la sagesse, et le cœur battant de l’humanité.