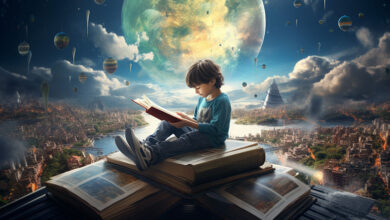L’art difficile de vivre dans la réalité

Il y a 45 ans, l’auteur s’est livré à des réflexions qui trouvent aujourd’hui d’étranges résonances avec les problèmes que nous entretenons avec la réalité.
L’inertie historique que nous portons tous à travers notre éducation plus ou moins encyclopédique, issue du siècle dernier, qui se targuait de « positivisme », a bouleversé de nombreux concepts fondamentaux et, pire encore, a faussé notre capacité de réflexion et de discernement.
Un moyen-âge mental ?
Il est curieux que de nombreuses personnes, qui utilisent pourtant des équipements techniques électroniques, n’aient pas quitté, mentalement l’ère de l’engrenage à huit dents, qu’utilisaient nos meuniers médiévaux.
Pour eux, tout s’explique, tout a son étiquette et pour ce qui n’en a pas, ils en inventent une et la collent… car il n’y a pas de plus grande horreur, pour ces amis « rationnels », que celle que produit l’inconnu. Et face à lui, ils le nient ou le transforment en quelque chose de familier et de rassurant pour leur esprit bourgeois.
Les erreurs du mental simpliste
Néanmoins, le mental rationnel simpliste, en lien avec la science conventionnelle, ne nous a pas toujours conduits à la vérité. Nous avons été trompés à de multiples reprises. La place disponible dans un article limite les exemples, mais on peut en citer quelques-uns.
Les universités du XIXe siècle niaient toute possibilité de vol pour les engins plus lourds que l’air, alors même que les oiseaux volaient devant leurs fenêtres. Ils déclaraient également que, en calculant les pressions, l’eau au fond des océans devrait être aussi solide et lourde que le fer, en raison de la compression des couches supérieures. Les impulsions électriques ne pouvaient pas être transmises sans un câble pour les transporter. Les traditions homériques n’étaient que des contes anciens. La télévision était impossible ; de même l’hypnose non magnétique. De même le canon sans recul, etc.
Le mental simpliste nous a trompés depuis des siècles, lorsqu’il nous a persuadés que la Terre était le centre de l’univers et qu’elle devait être plate. Que l’Amérique était une chimère même si Christophe Colomb montrait des hommes et des fruits manifestement non asiatiques. Que ce que Galilée voyait à travers ses télescopes étaient des reflets optiques et non des étoiles, puisqu’elles ne se voyaient pas à l’œil nu. Que l’imprimerie à caractères mobiles était lente et incapable de donner des couleurs à la manière des miniaturistes.
L’influence de la pensée scientifique
Le XIXe siècle n’a fait qu’introniser le totem de la « réalité scientifique » et renforcer le tabou envers tout ce qui n’était pas officiellement étiqueté auparavant. Ainsi, par une édification de la raison, on a voulu combattre la pensée thomiste qui cherchait à donner des habits rationnels à la foi.
Mais cette façon de sacraliser la raison apparente par la raison apparente elle-même était un gros mensonge, puisque les hommes ont volé dans des machines plus lourdes que l’air ; ils ont transporté des images par des moyens immatériels ; ils ont découvert Troie ; ils ont constaté l’existence de milliers d’étoiles invisibles à l’œil humain ; ils ont créé le canon sans recul ; ils sont descendus au fond de la mer avec leurs bathyscaphes (2) et ont trouvé de l’eau liquide.
La démocratie du savoir
La technique expérimentale a surpassé par l’expérience les conciliabules des académies, et les démonstrations qui avaient été « réfléchies », écrites en milliers de volumes, enchaînés par une pseudo-logique, que nous savons aujourd’hui être un sophisme, sous la forme grossière d’un syllogisme.
Cependant, même si nous savons toutes ces choses, nous continuons à répéter l’erreur dans d’autres domaines, parce que notre orgueil nous empêche de dire « je ne sais pas », et que l’on confond l’intelligence avec les connaissances, et la culture avec la lecture.
En outre, une sorte de « démocratie du savoir » fait que presque tous les hommes s’approchent et confirment a priori les affirmations de la majorité, sans savoir avec certitude si la plupart se fonde sur un jugement réel ou sur une opinion à la mode, poussée par la propagande.
L’art de vivre dans la réalité
L’art de vivre dans la réalité nécessite, en premier lieu, la décontamination des préjugés et l’abandon du concept erroné selon lequel la raison englobe la totalité de la réalité. Il est indispensable de revenir à un naturalisme philosophique où sont éliminés les intermédiaires entre la réalité et le concept.
Nous devons observer davantage et penser moins.
Il nous faut éradiquer le mensonge qui identifie l’imagination créatrice avec une fantaisie déformante, qui accorde des qualités inexistantes et les proclame comme des qualités axiomatiques, sacrées pour le troupeau de Panurge.
En définitive, la proposition de notre philosophie est de chercher la réalité et de ne pas déformer la nature profonde des choses. La vérité, plus elle est nue, plus elle est belle… et plus elle est vraie !
Il est triste, voire ridicule, que ce que l’on appelle ordinairement « dévoilement » n’ait concerné que les corps humains, pour se livrer aux déviations spéculatives du désir et non à la perception de la vérité.
Quand quelque chose n’est pas suffisamment connu aujourd’hui, on lui invente des attributs avant de l’avoir défini.
Cet « art de vivre dans la réalité » mentionné ci-dessus est un impératif de notre époque, si nous ne voulons pas périr écrasés sous le poids de nos propres mensonges.
Comme dit l’adage populaire : « appeler le pain « pain » et le vin « vin »».
Soyons simples, soyons honnêtes, soyons naturels ; et le philosophe qui sommeille en chaque être humain s’éveillera inexorablement et nous fera vivre des réalités, d’une puissance éthique et pragmatique.
Être philosophe n’est pas si difficile ; il suffit de se retrouver soi-même et d’oser dire : « je ne sais pas » quand on ne sait pas… Et tout le reste, comme le dit la maxime biblique, nous sera donné par surcroît. Dans la dynamique de ce processus se trouvent les germes d’une connaissance juste et d’une vie juste.