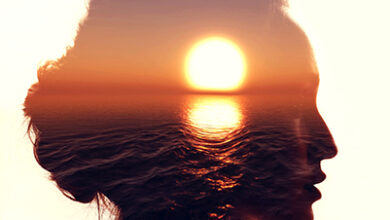À Lire : La philosophie pour éviter la guerre ?
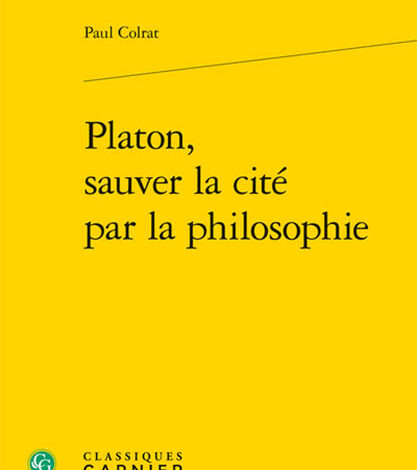
Que peut la philosophie face à la menace de la guerre ? C’est une de ces questions existentielles et essentielles à laquelle Platon a tenté de répondre tout au long de son œuvre. Ses réflexions et conseils, d’une totale actualité, sont savamment exposés par Paul Colrat dans son ouvrage récemment paru « Platon, sauver la cité par la philosophie » (1).
Il n’y a pas si longtemps, la question de la guerre n’intéressait que peu de personnes, avouons-le. Nous vivions du fruit de la tranquillité de huit décennies d’après-guerre et, malgré la compassion réelle pour les Ukrainiens, en proie aux combats, le danger restait lointain. Aujourd’hui, un brutal renversement d’alliance face aux ardeurs belliqueuses aux portes de l’Europe, nous met face aux réalités impérialistes qui menacent notre équilibre, mais aussi à notre impréparation devant ce danger, retranchés que nous étions dans notre illusion de sécurité et notre recherche de confort.
D’où cette brulante question : comment éviter la guerre ?
Ennemis extérieurs et intérieurs
Platon nous dit que la guerre est le pire des maux, puisqu’elle menace l’existence même de la cité.
Il y a bien sûr la guerre provoquée par les ennemis extérieurs, que le grec appelle polemos (qui a donné en français le mot « polémique »). Contre elle il est bon d’avoir des armes, des remparts pour se protéger, bien que ceci provoque la mollesse des citoyens qui ne songent plus à se défendre eux-mêmes (Lois, 778 e6). Car toute l’efficacité de la planification et la technique militaires ne garantiront pas la sauvegarde de la cité (Lois, 779 a4). Ce qui sauve, ce ne sont pas les remparts mais le courage des soldats, ce n’est pas la force mais la vertu, souligne Platon (République, 375b).
Mais, par-delà la guerre extérieure, le plus grand péril surgit lorsqu’elle trouve, face à elle, une cité désunie. Le véritable danger pour la cité, nous dit Platon, réside dans la stasis, mot complexe pour désigner la déchirure interne, qui signifie tout à la fois discorde, décadence et guerre civile. La stasis d’une cité est provoquée principalement par la démesure et l’excès (issus d’un rapport faussé au réel) ainsi que la désobéissance aux lois, source de l’injustice. Cette crise morale engendre des affrontements politiques suivis de guerres intestines qui culminent inévitablement, selon le philosophe, dans le chaos de l’anarchie puis de la tyrannie.
Autrement dit, le pire des ennemis est à l’intérieur.
Comment la philosophie peut-elle sauver la cité, comme le soutient Platon ? Il rajoute même qu’elle est la seule à pouvoir le faire ! C’est pourquoi il faudrait, selon lui, confier au philosophe le pouvoir de la prémunir des dangers, car il agira comme un médecin pour lutter contre le mal intérieur, tout comme les guerriers et les généraux luttent contre le mal extérieur.
Mettre fin à la discorde
Ce n’est pas la guerre interne, celle d’un camp contre un autre, dût-il emporter la victoire, qui mettra fin à la discorde. La stasis est une guerre qui n’a pas une solution guerrière. Autrement dit la fin des dissensions et la concorde politique ne s’obtiennent pas par la force. Selon Platon, c’est parce que les gouvernants conçoivent la politique comme une guerre continuée par d’autres moyens qu’ils ne parviennent pas à créer l’union. Chacun veut l’emporter sur l’autre.
Quelle est donc la potion magique pour consolider la cité, pour rassembler ce qui est divisé en une unité harmonieuse ?
Le pouvoir de la philosophie
Le philosophe construit la sauvegarde de la cité sur un mode différent de celui des remparts.
D’abord par la vertu. Le mensonge et la cupidité sont la cause de la corruption de la cité. Le bonheur de celle-ci s’obtiendra donc par la pratique et l’imitation d’exemple de vertus déclare le philosophe dans l’Alcibiade (132b). Il s’agit de se tourner vers le bien. C’est donc à une réforme morale qu’il convient de s’atteler, afin de réparer la perte de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. On ne cherchera pas à lutter contre les facteurs de corruption interne, ni à cantonner le rôle des lois à la seule rétention du mal, mais bien à établir l’harmonie entre les parties par la pratique commune de la vertu. Le meilleur rempart de la cité est son unité.
Les philosophes en seront les gardiens, tout comme les guerriers sont les gardiens de la cité vis-à-vis de l’extérieur. La République consacre de nombreuses pages à l’éducation de ces gardiens et gardiennes, qui doivent renoncer à tout et accepter de nombreuses exigences pour atteindre une forme de vie accomplie. Hommes et femmes de vertu, ils garantiront à la cité son harmonie. Philosophes, ils seront éducateurs de la raison, « moniteurs de sagesse », avec douceur et bienveillance, (V, 471a). Dans cette éducation la philosophie, mais aussi le chant et la musique ont leur place, comme l’explique Platon dans les Lois (II, 653a). Cette éducation visera à développer une certaine forme de vie propre à l’harmonie intérieure, individuelle et collective.
Ensuite la philosophie permettra de donner à chaque partie de la cité sa place propre, c’est-à-dire établira le règne de la justice, cette vertu reine qui suscite toutes les autres vertus (République IV, 433b8). Les lois ne sauvent pas la cité, dit Platon, et l’on sait bien qu’elles peuvent être contournées. Elles ont-elles-mêmes besoin d’être gardées, d’où les philosophes comme gardiens des lois, parce qu’ils sont justes eux-mêmes. Elles ont aussi besoin d’être servies par les dirigeants, car pour Platon, l’attitude de service est le meilleur remède à la corruption de la cité. (Lois, IV 715c8-d2). Servir plutôt que se servir, voici la base de la doctrine platonicienne.
Tout ce travail d’harmonisation ne peut cependant s’accomplir sans une dimension transcendante qui touche à l’universel. C’est pourquoi Platon arrime la sauvegarde la cité à la piété et à l’amour du savoir et la quête du vrai, autrement dit la philosophie, dont Socrate dit, à travers Diotime, qu’elle a le pouvoir d’engendrer une communauté durable. (Banquet, 209 c4).
L’avenir est-il aux philosophes ?
Pas sûr ! Car le philosophe est un empêcheur de profiter en rond. Il se situe délibérément hors du système pour ne pas en être dépendant et garder une vision plus large. C’est une distance qui le place hors de la cité et des pratiques politiques communes tout en séjournant dans la cité, détaille Platon dans le Théétète (173 e3). Cette distanciation est d’ailleurs le propre de la philosophie qui cherche la libération des phénomènes. Il s’agit de s’arracher à la caverne des opinions et des sensations pour atteindre le discernement du vrai et du faux. Ce désengagement philosophique n’est pas, pour autant, un désengagement politique. Car pour Platon la politique ne doit pas être fondée sur la politique, ni sur l’utilité et le pragmatisme, mais sur quelque chose qui dépasse la politique : la justice et la piété.
De plus le philosophe n’est pas l’homme d’un parti. Comme Platon, il s’efforce de penser une unité qui maintienne le plus possible la multiplicité et la diversité. A l’image de la forme de vie prônée par le philosophe, l’unité politique s’accommode de la contrariété des opinions. Néanmoins cette multiplicité qu’admet la cité philosophique n’est pas une simple superposition mais une articulation des différences éthiques. Platon pense la cité comme un orchestre qui sait créer l’harmonie par la juste tension et conciliation des opposés.
Pour tout cela, il n’est pas étonnant que le philosophe, indépendant, critique, mettant le doigt là où ça fait mal, proposant des perspectives hors des habitudes, soit mal aimé s’il n’est pas complètement ignoré. N’a-t-on pas condamné Socrate pour péché de corruption de la jeunesse alors même qu’il était en train de les détourner de la corruption qui conduira Athènes directement à la tyrannie ?
Nous ne pouvons que nous réjouir de la publication de ce livre dense, richement documenté, qui ramène la philosophie politique platonicienne au centre du débat, en regrettant toutefois son caractère parfois trop savant, notamment les concepts grecs, très rarement translittérés, qui peut rebuter des lecteurs moins érudits.