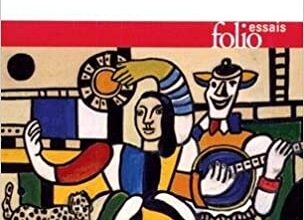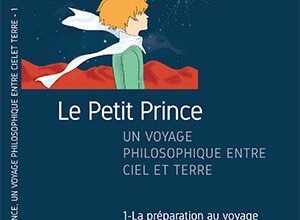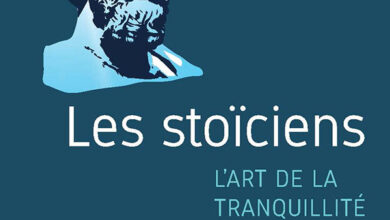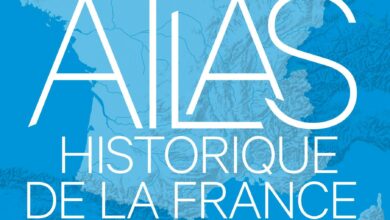Etty Hillesum, résister face à l’inacceptable

Durant la seconde guerre mondiale, quelques personnes ont fait face à l’adversité avec une force morale incroyable. Ce fut le cas d’Etty Hillesum, une jeune femme à la vie fulgurante.
Est-il possible de croire en l’humanité aujourd’hui ? Face au dérèglement climatique, aux problématiques sociales, à la montée de la violence, il difficile de ne pas sombrer dans la colère et la révolte. Pourtant, dans l’absurdité de son époque, Etty Hillesum nous a montré une autre manière de résister, beaucoup plus subtile et néanmoins plus difficile.
Une jeune femme amoureuse de la vie
Etty Hillesum était une jeune femme néerlandaise de confession juive, issue d’une famille bourgeoise : son père était un intellectuel taciturne, lisant beaucoup ; sa mère au contraire était très passionnée – trait de caractère dont Etty hérita. Elle eut deux frères dont un pianiste virtuose.
De sa vie, nous avons l’essentiel : son journal et les lettres envoyées depuis le camp de travail de Westerbork, témoignages d’une force morale saisissante. C’est entre 1941 et 1943, qu’elle démarre son journal, sous l’impulsion et la rencontre de Julius Spier (surnommé S dans son journal), disciple de Jung.
Elle y raconte comment les interdictions envers les Juifs vont être de plus en plus importantes, et surtout, la manière dont elle les vit : avec une force intérieure rare qui va l’amener à s’engager volontairement dans le camp de travail de Westerbork. Il ne s’agit pas pour elle seulement de protéger sa famille, mais d’aider ceux qui sont dans le camp à vivre et pas juste à survivre. Elle avait la possibilité de fuir Amsterdam. C’est donc en toute connaissance de cause qu’elle fit le choix d’affronter la souffrance et la mort. Depuis ce camp de travail, elle rédigera plusieurs lettres à ses amis, qui sont à la fois des témoignages de ce qu’elle y fait, et surtout de l’accomplissement d’un travail intérieur face aux atrocités qu’elle affronte.
S’engager pour résister
Pourquoi prendre un tel risque, un tel engagement ? Certains pourront y trouver une forme de naïveté, d’indolence, voire de résignation. Au contraire, comme elle l’explique, il y a un danger à se dire « nous ne voulons pas penser, nous ne voulons pas sentir, nous voulons oublier aussi vite que possible ».
Résister intérieurement ne veut pas dire se résigner, mais au contraire, travailler sur soi pour ne pas laisser les circonstances extérieures nous blesser ou enlever notre part d’humanité. Elle ajoute que « l’absence de haine n’implique pas nécessairement l’absence d’une élémentaire indignation morale », faisant la distinction entre haine et sentiment d’indignation :si le sentiment d’indignation est nécessaire pour avoir conscience d’une situation anormale ou injuste, la haine n’est pas nécessaire pour la changer. Aussi, pour Etty Hillesum résister se traduit de manière spirituelle : il s’agit d’une lutte sans faille pour retirer haine et violence en soi-même pour être pleinement disponible à l’autre et l’accueillir dans sa pleine humanité. Car, comme elle écrit dans son journal : « C’est tellement facile ce désir de vengeance. On vit dans l’espoir de ce moment de vengeance. Mais cela ne nous apportera rien. » Elle continue plus loin en ajoutant :« Au camp, j’ai senti que le moindre atome de haine ajouté à ce monde le rend plus inhospitalier encore. » Déjà, nous souffrons de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes tentés de trouver un coupable, d’accuser l’autre ou Dieu de cette souffrance. Ce qu’explique Etty Hillesum à travers son expérience dans les camps, c’est qu’en faisant cela, nous nous ajoutons davantage de souffrance, et nous rendons la réalité encore plus difficile à vivre, sans espoir de nous extirper vers un ailleurs.
Développer sa force morale
La seule solution pour créer cet ailleurs est de travailler sur notre force morale pour trouver en nous-même une source qui puisse nous nourrir et dépasser les circonstances extérieures, aussi difficiles soient-elles. Cette source se traduit chez elle, par une forme de mysticisme, une spiritualité qu’elle a façonnée au gré de ses lectures et de ses rencontres. La philosophie cherche aussi à nous relier à notre propre source en nous aidant à changer de regard sur le monde qui nous entoure, non pas pour vivre dans la rêverie, mais pour vivre avec la réalité du monde sans en être pollué. Le travail sur notre force morale nous aide à ne pas nous sentir victime, mais au contraire d’aller puiser à l’intérieur de nous-même, une force d’âme pour accepter la réalité sans en subir les conséquences émotionnelles, et pour vivre librement. C’est ce qu’exprime Etty par ces mots très puissants : « On ne peut rien nous faire, vraiment rien. On peut nous rendre la vie assez dure, nous dépouiller de certains biens matériels, nous enlever une certaine liberté de mouvement toute extérieure, mais c’est nous-mêmes qui nous dépouillons de nos meilleures forces par une attitude psychologique désastreuse. […] Je trouve la vie belle et je me sens libre. En moi des cieux se déploient aussi vastes que le firmament. […] la vie est difficile, mais ça n’est pas grave. »
Être libre
La vie est difficile, mais ça n’est pas grave. Dite hors contexte, cette phrase pourrait paraître naïve. Pourtant, elle demande fondamentalement du courage et de l’espérance. La véritable liberté est la liberté intérieure : celle que possède l’Homme pour choisir comment il accueillera son propre destin. Nous aimons parler de liberté aujourd’hui : cette valeur est écrite sur nos frontons. Nous aimons parler de nos droits, mais nous parlons rarement de nos devoirs. Etty Hillesum nous ramène à notre devoir d’humanité face à l’atrocité et à l’injustice : celui de choisir comment réagir face à cela pour ne pas rajouter de la haine à la haine. Cette liberté intérieure ne peut exister sans force morale, ce qui demande un travail intérieur : « Travailler à soi-même, ce n’est pas faire preuve d’individualisme morbide. Si la paix s’installe un jour, elle ne pourra être authentique que si chaque individu fait d’abord la paix en soi-même, extirpe tout sentiment de haine pour quelque race ou quelque peuple ce soit. »
La vie intérieure
Extirper tout sentiment de haine, en commençant par soi-même, en traquant tout jugement de valeur que nous portons aussi bien sur nous-même que sur les autres. C’est pourquoi, l’observation et le discernement sont essentiels dans un travail intérieur. C’est la première étape : accepter de se voir tel que nous sommes, sans nous sous-estimer, ni nous surestimer. Se jauger et non pas se juger. Pour autant, la seule observation ne suffit pas. Nous devons entrer dans une plus grande cohérence avec nous-même. Et pour cela, seule la confrontation à la réalité nous permet de mesurer si nous gagnons, ou non, en densité intérieure. C’est cela que nous pouvons constater chez Etty Hillesum : à mesure que le temps passe et, paradoxalement, à mesure que la situation des Juifs s’aggrave, nous lisons l’évolution de son attitude. Sa pensée n’est plus seulement intellectuelle, et c’est aussi comme cela que nous comprenons la philosophie pratique, une pensée en action, en prolongement.
« Hier, j’ai cru un moment ne pouvoir vivre plus longtemps, avoir besoin d’aide. J’avais perdu le sens de la vie et le sens de la souffrance, j’avais l’impression de m’effondrer sous un poids formidable, pourtant, j’ai continué à me battre, et voilà que je me sens capable de continuer, plus forte qu’avant. »
Le pouvoir de la transcendance
Le chemin vers sa vie intérieure n’est pas sans embûches. Il demande constance et persévérance. Constance par un travail continu sur sa pensée, et persévérance dans l’application de sa pensée. Ce qui est difficile à faire lorsque nous sommes pris par les émotions. Nous réagissons plutôt que nous ne pensons, prenant le risque de vivre à la surface du sens de la vie, sans jamais rentrer en profondeur et dans le silence. Ce silence, Etty Hillesum le nomme Dieu, terme qui lui permet de décrire la foi et la conviction de quelque chose de plus grand que soi qui l’habite. Par les temps qui courent, il est plus facile d’être désabusé que d’espérer et de se battre. Pensons à Etty Hillesum qui a fait face aux cadavres, à la maltraitance, à l’humiliation, et qui parvient à écrire : « Notre unique obligation morale, c’est de défricher en nous-mêmes de vastes clairières de paix et de les étendre de proche en proche, jusqu’à ce que cette paix irradie vers les autres. Et plus il y a de paix dans les êtres, plus il y en aura aussi dans ce monde en ébullition. »
L’espérance
L’espérance n’est pas juste un petit sentiment qui apparaît lorsque nous sommes au plus mal : elle se cultive, pour que jamais cette confiance en la vie, en l’humanité ne nous quitte. Face à l’absurdité du monde, nous avons le pouvoir de changer de regard. Ce pouvoir est à la fois une responsabilité et un devoir. C’est ce qui nous rend digne. Cette transformation du regard exige d’aller puiser en nous ce qu’il y a de meilleur, pour pouvoir servir et protéger au mieux la Terre, en toute légèreté, pour se coucher le moment venu, heureux de la trace que nous laisserons.
Concluons avec ces paroles de Etty Hillesum : « Les quelques grandes choses qui importent dans la vie, on doit garder les yeux fixés sur elles, on peut laisser tomber sans crainte tout le reste. Et ces quelques grandes choses, on les retrouve partout, il faut apprendre à les redécouvrir sans cesse en soi pour s’en renouveler. Et malgré tout, on en revient toujours à la même constatation : par essence la vie est bonne, et si elle prend parfois de si mauvais chemins, ce n’est pas la faute de Dieu, mais la nôtre. Cela reste mon dernier mot, même maintenant, même si l’on m’envoie en Pologne avec toute ma famille.» 26 juin 1943.
À voir sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=OvHinea8lYc&t=714s