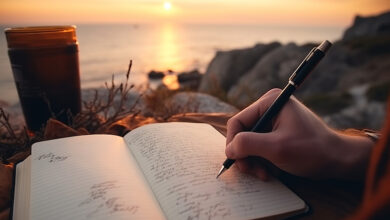Aujourd’hui, pour un jeune, choisir un métier est conditionné à de nombreux impératifs. À quoi donc peut servir l’éducation dans ces conditions ?
Cette lettre est adressée à un jeune dont j’ignore le nom, une de ces personnes que l’on croise dans la rue ou en faisant la queue à la caisse d’une boutique. Un jeune qui incarne et symbolise bien d’autres personnes vivant des situations similaires.
Il fut impossible de ne pas l’écouter alors qu’il confiait à un ami : « J’ai beaucoup de choses à étudier ; je ne pourrai pas sortir ce weekend… Même si, bien sûr, je n’étudie pas autant que je l’aurais voulu, car je n’ai pas obtenu assez de points pour envisager cette carrière… Bref, je me contenterai de ce que j’ai… »
Ces mots étaient accompagnés d’un rire artificiel, d’un ton déçu d’autodérision, d’une acceptation de règles d’un jeu que personne ne comprend.
La plupart des gens savent que notre monde évolue rapidement, que les choses ne sont plus comme avant, que ce qui était valable il y a peu a été oublié et remplacé par de nouvelles situations. Mais ces changements peuvent-ils affecter des aspects substantiels de l’être humain ?
Les conditions d’aujourd’hui pour déterminer une vocation
Jusqu’à tout récemment – et je crois que c’est toujours le cas –, certaines personnes exprimaient, dès leur plus jeune âge, le désir d’étudier quelque chose, de devenir quelqu’un, d’accomplir une tâche précise une fois devenues adultes. Il est certain que ces vocations pouvaient être déterminées par de nombreux facteurs, depuis la pression familiale jusqu’à la fantaisie, mais au moins il y avait une force intérieure qui dictait leur cap.
Aujourd’hui, si une vocation existe, s’il y a une volonté intérieure d’atteindre un objectif, elle doit se soumettre à un ensemble de conventions qui anéantissent malheureusement cette impulsion. Il y a des conditions impératives à envisager avant de prendre la décision de suivre une vocation. Quelles seront mes possibilités financières ? Quel prestige gagnerai-je aux yeux du public ? À quelle concurrence serai-je confronté ? Réussirai-je les examens de sélection ou devrai-je me mesurer à des candidats mieux recommandés que moi ? Obtiendrai-je les notes nécessaires pour intégrer la faculté de mon choix ou devrai-je m’orienter vers d’autres études ? Vais-je tenter d’obtenir un diplôme d’un établissement privé, bien que ce diplôme n’ait de reconnaissance nulle part dans mon pays ? Et si je ne poursuis pas d’études universitaires, que deviendrai-je ? Quel sera mon avenir ?
Nous vivons apparemment dans un monde où la communication est rapide et facile ; les États cherchent toutes sortes de normalisations au profit de leurs citoyens ; on parle de monnaies communes, de langues internationales sans négliger les langues locales, de solidarité mondiale… On parle tant de choses qui n’existent pas quand on les cherche ! Quand on ne peut que faire face à la réalité, force est de constater que nous sommes toujours aussi limités qu’il y a des décennies, et que seuls quelques établissements d’enseignement décident de l’avenir de milliers de jeunes. Il s’avère que si l’on n’étudie pas, on n’est personne, et si l’on étudie, on finit par se sentir moins que rien, car personne ne prête attention au jeune inexpérimenté qui n’offre que ses connaissances naissantes.
C’est une réflexion que je dois au jeune inconnu : l’éducation est-elle un moyen d’élever l’être humain et d’ouvrir des horizons dépassant sa propre évolution et celle de la société, ou est-ce une course vaine dans laquelle sont brisés les plus grands espoirs et l’intégrité psychologique de ceux qui seront les artisans de l’histoire de demain ?