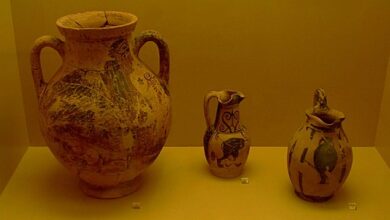« Il suffit d’une voix, d’un certain regard pour qu’on voie… un espoir toujours recommencé… Il arrive qu’un jardin ou qu’un simple visage humain… une main, ouvre un nouveau chemin… Et l’on voit soudain reverdir, refleurir notre espérance en l’homme »
Claude Nougaro
En ce début d’année 2025 où l’accélération vertigineuse de l’actualité mondiale semble précipiter les consciences dans une interminable course au vide, la France broie du noir comme le synthétise sobrement Julien Damon dans son analyse de l’enquête Fractures Françaises. 54% des français se disent appartenir à une France « mécontente mais pas en colère » ; 43% à une France « en colère et contestataire ». Et seul un petit 3% des Français, ce qui est bien peu, se dit se sentir proche d’une France « satisfaite et apaisée », quand pour les autres le paysage semble résolument sombre.
De fait, il n’est pas anodin de signaler que c’est le mot grec Hubris qui a connu la plus forte hausse des consultations en 2024 sur le dictionnaire en ligne Le Robert (1), un mot dont la définition proposée est : « sentiment d’orgueil qui pousse l’être humain à la démesure et entraîne sa perte », comme si quelque chose d’obscur se jouait dans ce sentiment très fort de perte du bien commun, quelque chose de ressenti par le plus grand nombre, tant au regard de l’état du monde que de notre pays.
Comme le dit Philippe Royer dans son livre S’engager pour le bien commun, un dirigeant partage son espérance (2) : « Ce monde qui ne va pas bien et qui vit une fin de cycle va vivre des chaos et des émergences » et face à cela : « Quand tout être humain aurait raison d’être désespéré, nous devons faire émerger un devoir d’espérance » (3). Voilà, le mot est lâché. Pour refuser la confrontation de tous contre tous, le repli dans l’égocentrisme, et continuer à tisser le l’étoffe du monde, nous avons besoin d’espérance.
Comme le dit Chantal Delsol : « Il n’existe aucun monde où il est impossible de parler d’espérance ». « Il n’y a aucun monde dans lequel il serait impossible de parler de grâce, d’amour et d’espérance. Même dans les camps nazis et communistes, il y avait des prisonniers qui irradiaient la grâce et l’amour » (4).
Nous voici semble-t-il à la croisée des chemins. Deux récits aujourd’hui semblent s’affronter, d’un côté celui de la désespérance, animé sans répit par la longue litanie des guerres, catastrophes climatiques, et bouleversements sociaux, et de l’autre, celui de l’espérance en l’homme. Un récit fait de toutes les pépites de générosité égrenées par le long fleuve du quotidien, que nul média ne relayera jamais, de tous les actes gratuits, de tous les héroïsmes qui permettent à notre société de rester debout, de toutes nos contemplations de la beauté et aspirations à la grandeur. Un récit des humbles assurément, un récit en actes et sans grands mots grandiloquents, juste un refus obstiné du plus grand nombre de s’accoutumer au mal et à la laideur.
Ce récit n’est pas religieux, il est bien au-delà. Il reflète un besoin d’autre chose, comme en témoignent les 860.000 visiteurs qui se sont pressés en longues files d’attente pour entrer dans Notre-Dame de Paris rayonnante, le premier mois de sa réouverture. Comme le dit Danièle Hervieu-Léger, nous sommes face à un engouement « pour des hauts-lieux qui manifestent la continuité, dans la très longue durée, d’un héritage religieux. Tout se passe comme si ces hauts-lieux défiant le temps offraient par leur seule existence présente la démonstration de la continuité à travers les siècles d’un « nous », capable de conjurer le sentiment de précarité irrémédiable induit par… l’incertitude menaçante du présent ». Il se joue là nous dit-elle « quelque chose d’une expérience du sacré, l’irruption de l’extraordinaire dans la morosité de la vie ordinaire et la réactivation de ce qui nous est commun, dans un moment de chaleur collective qui transcende les singularités des individus et leurs divisions et les tourne vers un horizon qui les dépasse » (5).
Cette même chaleur, ce même émerveillement d’enfant avait bouleversé la France et le monde cet été, en voyant la vasque olympique, cette grande boule lumineuse s’élever chaque soir dans le ciel de Paris. Quelque chose de plus qu’un simple spectacle s’est installé, quelque chose de profond, de l’ordre de la contemplation. La contemplation dit Sophie Fontanel, « ce n’est pas juste contempler quelque chose de très beau pour s’élever, c’est réaliser des connexions à l’intérieur de soi-même pour entrer en relation avec le monde » (6). Et, ils étaient des milliers à contempler, pressés les uns contre les autres, chaque soir, à vivre cette étrange communion joyeuse et émue en voyant la boule de feu s’élever. « Plus encore qu’un tour de magie, c’était un miracle, notre émerveillement possible dans une actualité abominable… nous avons tous ressenti la même chose : la contemplation de cette boule a répondu à un profond besoin d’élévation ».
Nous sommes appelés à une forme de résilience. Philosophiquement, l’intérêt de la lumière, c’est qu’elle transperce toujours l’obscurité, et il en est de même de l’espérance. Même si l’âme du monde nous semble envahie par l’obscurité, le pire n’est jamais certain car l’âme humaine, quand elle retrouve le chemin de l’élévation, retrouve aussi sa source d’espérance, de beauté et de transcendance. Comme le disait le philosophe Gustave Thibon : « Ce n’est pas la lumière qui manque à notre regard, c’est notre regard qui manque à la lumière. »
Alors, cherchons à pratiquer la philosophie comme une sagesse de vie, en sachant que chaque jour, au-delà des tumultes, il nous est possible de renouer avec la profondeur de l’âme. Réconcilier l’action et la contemplation, cultiver notre capacité à nous émerveiller de la beauté, pour conjurer la précarité et le doute, c’est permettre que l’élévation reste notre cap dans un monde à la dérive.
La philosophie est une boussole d’espérance. Elle nous rappelle que, même dans la nuit la plus profonde, l’homme demeure un être en quête de sens.